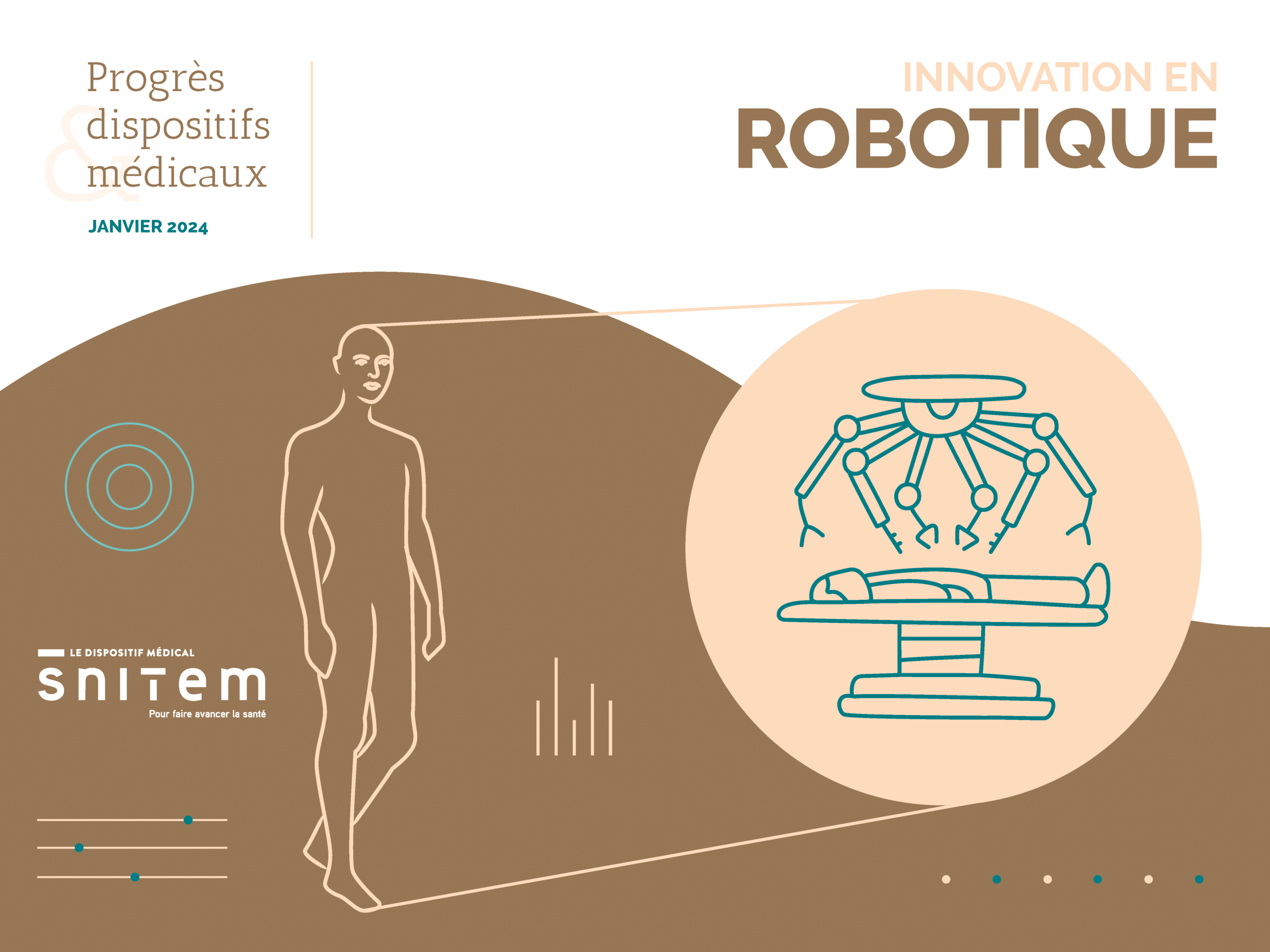Livret robotique – édition 2024
Un nouveau livret du Snitem de la collection consacrée à l’histoire de l’innovation des dispositifs médicaux fait l’objet d’une édition revue et augmentée en ce début d’année. Il s’agit de celui consacré à la chirurgie robot-assistée.
« Visualiser ce que l’œil ne peut pas voir », pour une « chirurgie plus précise mais surtout personnalisée ». C’est en ces termes que le Pr Patrick Pessaux, président de l’Association française de chirurgie (AFC), qui signe la préface du nouveau livret du Snitem, décrit l’innovation en chirurgie robot-assistée. De fait, vingt-cinq ans après l’apparition de la première génération de robots chirurgicaux, ces derniers sont désormais présents dans la quasi-totalité des spécialités : chirurgie générale, urologie, chirurgie digestive et thoracique, gynécologie, pédiatrie, ORL, orthopédie, neurochirurgie… Une preuve de la volonté des industriels d’améliorer sans cesse leurs dispositifs pour répondre aux besoins des patients comme des praticiens.
Accroître le service médical rendu
Offrant précision et finesse, les robots chirurgicaux permettent d’accéder à des zones anatomiques difficilement accessibles à la main de l’homme et de bénéficier d’une visualisation claire de la zone à opérer. L’objectif ? Accroître le service médical rendu. En parallèle, leur essor favorise la diffusion élargie des bonnes pratiques chirurgicales, la standardisation et l’optimisation des protocoles opératoires, le compagnonnage et le partage d’expériences, l’attractivité des établissements et de nouvelles organisations humaines.
Les éclairages des éminents chirurgiens interviewés pour ce livret révèlent également les améliorations et perspectives à venir, au premier rang desquelles l’inclusion de l’imagerie peropératoire, la collecte de données provenant tant du patient que du chirurgien et l’intégration de l’intelligence artificielle. C’est donc une véritable révolution de l’écosystème chirurgical qu’engendre la robotique, mais toujours en laissant le chirurgien, sa réflexion et son expertise au centre de toute procédure !
Un dispositif, des disciplines
La robotique interventionnelle peut avoir diverses applications et intervenir dans toutes les spécialités chirurgicales et interventionnelles. Sa place ne cesse de grandir.
Le but est à chaque fois le même : atteindre la zone à opérer ou à observer de la manière la plus précise possible tout en étant le moins invasif possible et opérer sans ouverture en minimisant les traumatismes tissulaires. En cardiologie, par exemple, cela consiste à réaliser des actes chirurgicaux sur les cavités, les vaisseaux et les valves cardiaques sans recourir à la chirurgie à cœur ouvert. Les progrès accomplis en matière de robotique, notamment la robotisation du cathétérisme, permettent désormais aux cardiologues ou aux urologues, comme aux radiologues, de recourir à un cathéter et aux rayons X afin de pouvoir atteindre à n’importe quelle partie du corps, si difficile d’accès soit-elle. Ainsi, en télémanipulant le cathéter à distance, les professionnels de santé ne sont plus exposés aux rayons X. Or, quand ils sont munis d’un tablier plombé, celui-ci ne recouvre pas entièrement le corps et, d’autre part, il est également extrêmement lourd. Les bénéfices sont donc multiples pour les professionnels de santé : meilleure ergonomie au travail, protection contre les risques d’irradiation, amélioration drastique de la sécurité. Du côté du patient aussi les avantages sont nombreux car le travail des professionnels de santé gagne en qualité et en précision. Il est donc exposé aux rayons X pendant moins longtemps qu’auparavant, on lui injecte moins d’iode et on lui pose moins de stents car ceux-ci sont d’emblée bien posés. En un mot, la robotique en cardiologie interventionnelle permet aujourd’hui d’être toujours moins invasif et toujours plus précis. En chirurgie, le robot va conduire des instruments miniaturisés et très précis introduits au travers de trocarts et d’orifices punctiformes. Il peut être couplé à une vision magnifiée en 3D ou à la réalité augmentée qui apporte au chirurgien la superposition de la situation de son instrument par rapport aux structures reconstituées, le tout en temps réel et calculé grâce à une acquisition préalable par scanner ou IRM. D’autres robots peuvent optimiser l’implantation d’une prothèse osseuse en calculant le plan de coupe osseuse optimal, voire en le réalisant.
Le robot n’a pas d’autonomie : on parle en effet de télémanipulation. C’est l’opérateur qui réalise un geste optimisé ou qui garde le contrôle sur un geste automatisé. En chirurgie vasculaire, il s’agit de réaliser une micro-incision par laquelle le cathéter est introduit dans les vaisseaux grâce à des instruments souples et allongés. Le cathéter est guidé jusqu’à la zone d’intervention grâce à un câble qui le rigidifie pour permettre sa progression et qui est doté d’une pointe très souple afin de ne pas endommager d’artères. Le professionnel de santé intervient quant à lui depuis un cockpit distant et protégé où il est assis (et non plus debout comme auparavant) devant plusieurs écrans qui lui permettent d’intervenir et de contrôler. Le robot chirurgical abdominal ou thoracique est aussi commandé par une console à proximité du patient mais d’autres robots monobloc sont au contact.
« Le premier robot reposant sur ce genre de technique a en fait été utilisé par l’armée américaine pour mener des opérations dans des zones irradiées où un chirurgien ne pouvait pas se rendre, relate le Pr Philippe Grise, chef du service urologie du CHU de Rouen. Le robot était commandé à distance. Mais il faut préciser que l’appareil est resté un concept et n’a alors pas connu de développement particulier. » Néanmoins, les réflexions menées dans divers domaines, dont l’armée, sur les technologies de pointe se retrouvèrent par la suite dans le monde médical. Avec l’explosion des pathologies cardiovasculaires et des cancers (notamment de la prostate), le besoin de gagner en précision (du geste et de l’image) et en sécurité dans les interventions devient une priorité. C’est pourquoi, dans les années 2010, la robotisation interventionnelle est entrée en scène. « La robotisation permet d’augmenter la dextérité du chirurgien et la précision de son geste, explique le Pr Grise. Elle rend également possible des opérations qui ne l’étaient pas jusque-là, comme celle de nodules pulmonaires de petite taille. » Les bénéfices pour les patients sont également multiples, précise l’expert : « L’ensemble de ces techniques robotiques permet de pratiquer une chirurgie mini-invasive, moins agressive et plus précise. Cela entraîne de facto une diminution de la durée d’hospitalisation, des douleurs et des effets secondaires. »
Des frontières de plus en plus floues
Dans le futur, la robotique interventionnelle va jouer un rôle de plus en plus important, en particulier en médecine vasculaire, une discipline qui concentre les plus grandes urgences, qu’elles soient hémorragiques ou thrombotiques (délivrance, déchocage, accident de la route, rupture de la rate etc.). Et ce, d’autant plus que le facteur temps est un facteur majeur du pronostic vital fonctionnel et que le meilleur traitement est l’embolisation et donc le recours au cathétérisme. Or, la robotique interventionnelle fait gagner ce temps précieux en opérant à distance et en évitant ainsi de transférer le patient depuis son site d’accueil d’urgence. Mais ce recours grandissant à la robotique interventionnelle n’est pas sans poser des questions quant à son impact sur l’organisation des soins et sur les professions de santé elles-mêmes, comme le prévoit le Pr Grise : « La robotique interventionnelle intervient déjà dans des champs étendus qui pourront s’étendre encore plus demain. Il n’y a pas de limite en termes de spécialités concernées. Plus encore, la robotique va transcender la notion même de discipline médicale, laquelle va devoir se restructurer. Il en va de même pour les métiers : par exemple, les métiers de l’imagerie, tels que le radiologue, vont rejoindre les métiers du geste tels que le chirurgien. Il va falloir repenser et redéfinir les contours des métiers pour travailler ensemble. » Une réflexion qui ne s’arrête d’ailleurs pas aux frontières des métiers médicaux mais concerne également les métiers paramédicaux : vont en effet devoir être instaurées de nouvelles coopérations interprofessionnelles qui, pour être mises en place, nécessiteront une formation à l’utilisation du robot. Enfin, « il sera probablement nécessaire d’engager une réflexion éthique avec l’ensemble des acteurs impliqués, dont les associations de patients et d’usagers, afin de garantir la pérennité de la relation humaine entre le professionnel de santé et le patient. Il est certain que la consultation d’annonce sera d’autant plus importante pour rassurer sur l’activité humaine et la place du robot. »
Le saviez-vous ?
Le terme robot est apparu pour la première fois en 1921, dans la pièce du dramaturge tchécoslovaque Karel Capek « R.U.R (Rossumovi Univerzalni Roboti) ». Le mot robot est en réalité un néologisme tiré du mot tchèque « robota » qui signifie « travail, corvée ».
Un entrainement de haut niveau
Il existe des simulateurs pour permettre aux chirurgiens de s’entraîner à la manipulation des robots. « On reproduit, au moyen d’une console opératoire, des opérations reconstituées, exactement comme le font les pilotes d’avion pour s’entraîner au vol, explique le Professeur Grise. C’est très important d’un point de vue éthique et quant à une éventuelle inquiétude du patient. Cela répond à un critère essentiel dans la tradition médicale française : jamais la première fois sur le patient. Jadis, on regardait faire le maître, puis on l’aidait avant de faire seul. La simulation permet d’apprendre et répéter les gestes, à l’envi. En outre, cela offre un avantage pour la formation puisque les simulateurs indiquent les performances et permettent donc d’évaluer les chirurgiens. » Assurément, demain, ce sera là une exigence légale voire de la part des assurances. La preuve en est que la simulation commence à intégrer les cursus même si elle n’est pas obligatoire.
(Sources : British Medical Journal, Circ Cardiovasc Interv, Cardiovascular Revascularization Medicine, The American Journal of Cardiology, BMC Public Health, Journal of the American College of Cardiology)