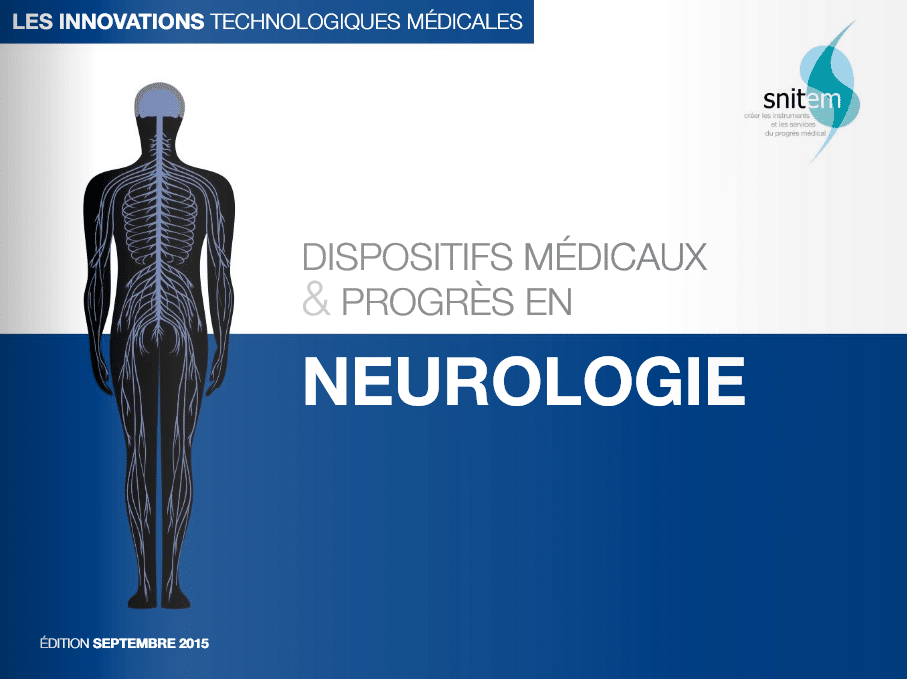Livret neurologie
Préfacé par le Professeur Didier Leys, le livret revient sur une discipline jeune et en plein essor. Les nouveaux outils de diagnostic, l’essor de la neuroradiologie interventionnelle, les perspectives d’avenir pour l’AVC, les techniques stéréotaxiques, la révolution grâce à la neurostimulation sont quelques exemples des sujets traités.
1. Préface du Pr Didier Leys
La neurologie, une discipline jeune et en plein essor
Pr Didier Leys, Président de la Société française de neurologie, CHU de Lille, INSERM U 1171
La neurologie est une des disciplines qui a le plus tiré bénéfice des progrès réalisés dans le domaine des dispositifs médicaux.
Le diagnostic des affections neurologiques avait déjà tiré profit de techniques neurophysiologiques, mais il a été transformé par l’apport de l’imagerie cérébrale en coupe, d’abord le scanner, puis l’imagerie par résonance magnétique. Ces techniques ont permis d’identifier directement des lésions cérébrales parfois de petite taille, d’en préciser la nature, et d’en surveiller l’évolution de façon non invasive. Elles ont même parfois un effet pervers, qui est la découverte fortuite de lésions silencieuses dont l’évolution naturelle n’est pas connue, qui inquiètent les malades, et qui incitent parfois les médecins à des traitements dont la justification n’est pas toujours validée. Aux progrès considérables de l’imagerie morphologique se sont vite associés les progrès de l’imagerie fonctionnelle qui ont permis de comprendre le fonctionnement du cerveau et d’identifier des anomalies fonctionnelles dans certaines pathologies dégénératives. Dans l’ensemble, les maladies neurologiques sont donc diagnostiquées plus tôt et plus précisément, ce qui, dans de nombreux domaines, est un gage de meilleure prise en charge.
Le traitement des affections neurologiques a également fait un bond considérable grâce aux progrès technologiques. La stimulation cérébrale profonde, dans la maladie de Parkinson et dans d’autres affections du système nerveux central, la neurostimulation dans les douleurs neurogènes et dans certaines séquelles sphinctériennes, la neuroradiologie interventionnelle, dans les malformations vasculaires et dans certaines ischémies cérébrales avec occlusion d’un gros tronc artériel, la radiochirurgie stéréotaxique dans le cas de certaines tumeurs ou malformations, en sont les principaux exemples.
Ce numéro consacré à la neurologie illustre la place prise par les dispositifs médicaux dans cette discipline jeune et en plein essor qu’est la neurologie.
2. Neurologie : une discipline en pleine mutation
Le poids que représente le cerveau dans le corps (2 %) est inversement proportionnel à son rôle. Les centaines de milliards de neurones qui le composent font de lui le siège de l’activité intellectuelle et sensitive. Il assure les fonctions vitales – en contrôlant le rythme cardiaque, la température corporelle, la respiration – mais aussi des fonctions dites supérieures telles que le langage, le raisonnement ou encore la conscience. C’est pourquoi la science médicale s’intéressant aux pathologies du système nerveux est en constante évolution depuis son essor, dans sa forme moderne, dans les années soixante. Elle fait même partie des disciplines les plus fécondes.
En tant que telle, la neurologie moderne est une discipline plutôt récente. « Au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, la médicalisation de la folie a coïncidé avec la naissance de la clinique et l’internement asilaire. Dès les années 1850, la médecine a identifié plusieurs maladies mentales et une scission s’est opérée entre la neurologie et la psychiatrie » explique Jean-François Picard, historien des sciences au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) Auparavant, en effet, cette expertise faisait partie d’une spécialité globale appelée neuropsychiatrie, laquelle regroupait l’ensemble des maladies du cerveau. Dès lors, les neurologues traitèrent les maladies causées par les lésions du système nerveux, comme l’aphasie motrice de Broca, mais aussi la maladie de Parkinson , l’épilepsie, la chorée de Huntington. Quant à la psychiatrie, elle fut dès lors réservée à la prise en charge des dérèglements du comportement et des névroses qui devinrent l’objet de la psychanalyse freudienne.
A l’aube du XXe siècle, après de nombreuses tentatives impulsées depuis vingt-cinq ans par le médecin britannique Victor Horsley, apparut une technique qui révolutionna la clinique des maladies mentales : la neurochirurgie. Jusqu’alors, la chirurgie du cerveau s’était en effet peu ou prou résumée aux trépanations, c’est-à-dire à l’ouverture du crâne. La neurochirurgie n’est en fait apparue que lorsque les chirurgiens et les neurologues ont osé, méninges ouvertes, intervenir sur le cerveau. Ce bouleversement était intrinsèquement lié à deux phénomènes : d’une part, la naissance d’un courant des neurosciences, la neuropsychologie, qui a bâti une médecine du système nerveux de plus en plus précise dans ses fondements anatomiques, physiologiques et cliniques. D’autre part, l’avènement de l’ère pasteurienne qui, évitant l’infection, autorisa l’ouverture des méninges. En France, c’est le médecin Joseph Babinski qui a ouvert la voie à la chirurgie du cerveau.
Les techniques d’imagerie cérébrale qui se développèrent après la Seconde Guerre mondiale constituèrent une autre innovation majeure sur le plan clinique car elles permirent d’avoir progressivement accès à l’anatomie du cerveau et de mieux comprendre le fonctionnement des régions cérébrales responsables des activités motrices, sensorielles ou cognitives. Une technologie révolutionna particulièrement la radiologie diagnostique : la création du scanner par coupe dans les années soixante-dix par le chercheur britannique Godfrey Newbold Hounsfield. Cet appareil d’imagerie médicale était et est toujours utilisé en cas de polytraumatisme majeur ou de traumatisme crânien ou encore pour apprécier la réponse au traitement de certains cancers. En 1973, l’invention de l’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) par Paul Lauterbur et Peter Mansfield marqua également une avancée significative dans la prise en charge de ces maladies car elle permit d’obtenir des images plus nettes et tridimensionnelles et donc de mieux comprendre la maladie et la traiter. « Par la suite, les améliorations techniques des IRM bouleversèrent encore la donne. Alors qu’à ses débuts, on ne pouvait voir que le cerveau, celui-ci dévoila bientôt les vaisseaux », explique Didier Leys. L’invention de la Tomographie par Emission de Positons•G (TEP), en 1975, permis d’étudier certaines pathologies du système central comme les Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC) et l’épilepsie. En mettant en évidence la destruction de certains neurotransmetteurs avant que le diagnostic ne soit fixé, elle révéla aussi certaines maladies neurodégénératives telle la maladie de Parkinson.
Des années soixante-dix à quatre-vingt-dix, la discipline s’organisa et s’équipa tandis que ses processus se formalisèrent. « À la fin des années soixante-dix, les patients atteints d’accidents vasculaires ne bénéficiaient pas d’imagerie. Dix ans plus tard, la plupart effectuait un scanner dans la semaine. Au début des années quatre-vingt-dix, quasiment tous y avaient accès dans la journée. En 1995, le scanner était effectué dès l’arrivée des malades ! » résume Didier Leys, Président de la Société Française de Neurologie (SFN). L’avènement de l’imagerie a d’ailleurs permis de développer à la fin des années quatre-vingt-dix des études sur les traitements actifs comme la thrombolyse intraveineuse. « Au début des années deux mille, précise Didier Leys, ce traitement était réservé à quelques hyper spécialistes issus de structures extrêmement organisées, lesquels ont ensuite formé leurs pairs, jusqu’à ce qu’il devienne une technique de routine pratiquée dans tous les CHU et presque tous les hôpitaux généraux. Aujourd’hui, la plupart des 140 unités neurovasculaires pour les AVC en France offrent cette prise en charge et c’est là un chiffre optimal pour la France. »
Hyperspécialisation des professionnels de santé
Parallèlement, une autre évolution, cette fois organisationnelle, modernisa considérablement la discipline. En effet, au début des années quatre-vingt-dix, imitant l’Hôpital de la Salpêtrière et le CHU de Toulouse avec les pathologies vasculaires, la neurologie devint hétérogène et cloisonnée, constituée d’hyper spécialistes. Neurologue généraliste durant les douze premières années de sa carrière, Didier Leys s’occupe par exemple uniquement, depuis plus de vingt ans, des accidents cérébraux. En effet, explique-t-il, « les essais cliniques ont montré que les patients suivis par des professionnels formés s’occupant d’une seule pathologie étaient mieux pris en charge et plus rapidement car les filières s’organisent de manière plus efficiente, avec les Samu, les radiologues, les urgentistes. Cela permet de prévenir davantage les complications pour les AVC et d’éviter les récidives, les phlébites et les pneumopathies. Bref, l’hyper spécialisation a permis d’améliorer le pronostic vital et fonctionnel des patients et de développer la recherche ».
L’avènement de la neuroradiologie interventionnelle et des dispositifs médicaux implantables dans les années quatre-vingt-dix constitua une autre étape majeure car ces outils permirent de traiter les anévrismes et les malformations des vaisseaux. « Dans les années soixante-dix et quatre-vingt, seule la chirurgie à crâne ouvert était permise. De nos jours, un grand nombre de patients peuvent être traités par voie radiologique, grâce à un cathéter dans lequel on place des coils, sortes de ressorts bouchant l’anévrisme. Des études scientifiques ont montré que cette technique était particulièrement efficace, voir plus efficiente que la chirurgie dans certains cas », précise le Président de la Société française de neurologie.
Une discipline particulièrement féconde
La neurologie est l’une des disciplines les plus fécondes en innovation et ne cesse d’évoluer, notamment grâce au développement rapide de techniques de diagnostic et thérapeutiques. Ces vingt dernières années ont en effet vu naître un grand nombre de nouveaux dispositifs qui offrent de nouvelles perspectives à la prise en charge des pathologies neurologiques. C’est le cas de la stéréotaxie, une technique de repérage tridimensionnel utilisée pour atteindre, depuis l’extérieur et avec le maximum de précision, des petites structures pathologiques à l’intérieur du cerveau. On connaît, grâce à cette technique, les fonctions des zones les plus profondes de l’encéphale et le siège des lésions originelles. Il est ainsi possible de détruire le mal directement au niveau des zones malades. Il en est de même pour la thrombectomie mécanique, un nouveau traitement intra-artériel des AVC aigus. Ce nouveau procédé consiste à insérer un cathéter dans un vaisseau sanguin à travers une petite ouverture dans l’aine et à avancer jusqu’à une artère cérébrale avant qu’un micro-cathéter soit poussé jusqu’à l’artère bloquée dans le cerveau. Le caillot est ensuite capturé à travers le cathéter. « Cette technique particulièrement efficace a été scientifiquement prouvée », se réjouit Didier Leys, Président de la Société française de neurologie. Les évolutions de la biologie moléculaire et de la physique technologique ont été déterminantes dans la naissance d’une neurologie moderne. Aujourd’hui, les progrès numériques, robotiques et génétiques pourraient révolutionner cette discipline. « L’industrie neurotechnologique est en forte croissance depuis plusieurs années et permet de grands avantages économiques aux communautés qui ont réussi à la développer, estiment les auteurs de l’étude réalisée en 2012 sur le marché des dispositifs médicaux en neurologie par l’Agence d’Intelligence Economique Franche-Comté (AIEFC). Et d’ajouter : « La collaboration étroite des connaissances de forte intensité entre des institutions, des investisseurs, des entreprises et des travailleurs favorise la création d’emplois de haute qualité, l’afflux de capitaux
d’investissement et de la croissance économique plus forte ».
Un divorce consommé
Si, aujourd’hui, la neurologie a acquis ses lettres de noblesse, cela n’a pas toujours été le cas. En effet, après la séparation des deux disciplines en 1968, neuf praticiens sur dix choisirent la psychiatrie ! L’Autriche a été le dernier pays en Europe à effectuer cette séparation... en 2013 !
A savoir
Les médecins de l’Egypte ancienne ont été les premiers à décrire le cerveau, le liquide céphalorachidien dans lequel il baigne et les méninges qui l’enveloppent. Ils ont aussi été les premiers à réaliser des trépanations. Dans le papyrus Edwin Smith, véritable traité de traumatologie datant de 1550 av. J-C, les méninges y sont comparées aux plissements se formant à la surface du cuivre fondu… Ils furent aussi les premiers à faire le lien entre certaines atteintes neurologiques et des blessures ou des lésions de la tête et du cou, comme les troubles de la marche, la raideur de la nuque, la déviation des yeux ou encore les maux de tête et l’hémiplégie traumatique. Pourtant, cet organe mal connu - les Égyptiens attribuaient en effet au cœur la direction de l’ensemble du corps humain - était peu considéré… au point d’être extrait du crâne du défunt lors de la momification, sans en assurer la conservation, contrairement aux autres organes.
3. Diagnostic - Activité électrique du cerveau
Activité électrique du cerveau : explorer pour mieux diagnostiquer
En enregistrant l’activité électrique du cerveau, les électrodes peuvent aider au diagnostic des pathologies neurologiques, permettant ainsi de mieux guider le traitement. Elles constituent une étape pré-opératoire indispensable dans le cadre de la prise en charge de l’épilepsie.
Sur le plan physique, l’Électroencéphalogramme (EEG), dispositif permettant de mesurer l’activité électrique du cerveau, est le seul marqueur en temps réel de l’activité cérébrale. Il sert particulièrement à prendre en charge l’épilepsie car il indique l’endroit où des convulsions et des crises épileptiques commencent. Il existe différentes techniques : l’EEG cutané de surface qui consiste à recueillir l’activité bioélectrique cérébrale, au moyen d’électrodes ; l’EEG sous-dural, aussi appelé « corticographie », qui est un examen consistant à disposer des électrodes sur le cortex cérébral pour enregistrer les anomalies; ou encore la Stéréo-électroencéphalographie (SEEG), réalisée à l’aide d’électrodes implantées dans la profondeur du cerveau, notamment pour l’exploration intracérébrale des épilepsies partielles pharmaco-résistantes. D’autres techniques particulières d’enregistrement peuvent par ailleurs être utilisées : EEG de sommeil chez l’adulte, EEG avec activation médicamenteuse, EEG couplé avec un enregistrement vidéo du comportement du patient, enregistrement à distance ou télémétrie, enregistrement ambulatoire etc.
Le cerveau travaille en permanence, même pendant le sommeil. L’EEG traduit ces courants sous forme de courbes caractéristiques de chaque région du cerveau, lesquelles sont ensuite analysées par le médecin. « Les ondes cérébrales se fracassent et s’épuisent considérablement à cause de la boîte crânienne. L’EEG est donc un reflet très utile de l’activité spontanée cérébrale », explique Jean-Marie Scarabin, Professeur honoraire à la faculté de Médecine de Rennes et ancien chef de service spécialisé dans la chirurgie de l’épilepsie.
Les premières études sur l’activité électrique du cerveau n’auraient pu exister sans l’invention, en 1875, de l’Électroencéphalogramme (EEG) par le scientifique britannique Richard Caton. « Dans les années vingt, les premières études chez l’homme furent attribuées au physiologiste allemand Hans Berger, indique Jean-Marie Scarabin. Il enregistra le premier signal d’activité cérébrale en 1929 et décrivit les premiers types d’ondes cérébrales ainsi que les tracés inhabituels chez les patients épileptiques. » Il fallut attendre les années cinquante pour que l’EEG soit couramment utilisé dans la pratique médicale, en particulier pour le diagnostic de l’épilepsie. En 1968, l’invention, par les américains David Cohen et James Zimmerman, de la Magnétoencéphalographie (MEG), méthode de neuro-imagerie consistant à enregistrer, en temps réel, l’activité électromagnétique du cerveau, changea la donne : le crâne ne constituait désormais plus une barrière.
Des électrodes in situ
En 1974, l’équipe du psychiatre et neurochirurgien français Jean Talairach, qui avait réalisé la première opération de stéréotaxie (procédure opératoire guidée par l’image) en 1948, eut l’idée d’implanter des électrodes dans le cerveau, marquant ainsi les prémices de ce qu’on appelle aujourd’hui la Stéréoélectroencéphalographie (SEEG) ou électroencéphalographie stéréotaxique. Cet examen repose sur la mesure de l’activité électrique du cerveau pour diagnostiquer une pathologie neurologique ou suivre les effets d’un traitement. « C’était une révolution car, auparavant, les électrodes étaient déposées à la surface du cortex », se remémore le Professeur Scarabin. La SEEG fut rapidement utilisée dès le début des années 2000. Ces électrodes invasives peuvent aujourd’hui être utilisées pour une période d’exploration maximum de trente jours. Outre l’amélioration de leur connectique, elles ont été considérablement miniaturisées. Elles mesurent ainsi 0,8 millimètre de diamètre, au lieu de 2,45 originellement. Par ailleurs, les électrodes, sont désormais fabriquées en platine iridium, un matériau biocompatible, et non plus en inox.
Exportation de la Méthode TailaracH
Jusque dans les années deux mille, les SEEG furent essentiellement utilisées en France de manière relativement confidentielle à Paris, Rennes et Lyon. Mais la méthode s’est récemment développée et exportée, remplaçant peu à peu la corticographie•G . « La SEEG est intéressante car les enregistrements à l’intérieur du cerveau sont plus fins et précis qu’à la surface du cerveau. Cela permet d’observer très précisément les crises d’épilepsies naissant dans la face interne du lobe temporal », analyse le Professeur Scarabin. En outre, cette méthode est moins invasive, donc plus confortable pour le patient : « Une corticographie nécessite d’ouvrir le crâne, ce qui entraîne des risques infectieux, alors que poser des électrodes se fait en perçant un petit trou avec un foret. »
Du diagnostic au traitement
La SEEG constitue, selon Jean-Marie Scarabin, un véritable enjeu d’avenir. « Le diagnostic est désormais meilleur grâce à l’apparition de microélectrodes capables d’enregistrer des phénomènes très fins au niveau d’un tout petit groupe de neurones. On peut également réaliser des microdialyses, c’est-à-dire analyser les produits chimiques secrétés dans l’environnement de la microélectrode. Par ailleurs, différentes équipes l’utilisent dans le cadre de la stimulation, notamment pour prendre en charge la maladie de Parkinson ». Longtemps cantonnées à un rôle diagnostic, les électrodes pourraient donc également, à l’avenir, être utilisées en thérapeutique. « C’est d’ailleurs déjà partiellement le cas, en particulier à Lyon, puisque depuis quelques années, les neurochirurgiens réalisent aussi, des thermocoagulations : on utilise alors ces électrodes pour détruire des lésions à l’intérieur du cerveau grâce à un générateur de radiofréquences qui envoie un courant entre deux contacts de l’électrode, lequel provoque un échauffement et nécrose la lésion, précise Jean-Marie Scarabin. Dans certains cas, cela permet de guérir des structures, en particulier dans le lobe temporal. »
La stimulation du nerf vague, une thérapeutique intéressante pour l’épilepsie pharmacorésistante
Introduite il y a plus de vingt ans, la thérapie par Stimulation du Nerf Vague (SNV) est désormais une option thérapeutique reconnue pour traiter l’épilepsie pharmacorésistante ou les patients qui ont suivi un traitement chirurgical mais qui continuent à subir des crises. Elle consiste à implanter un petit dispositif ressemblant à un stimulateur cardiaque dans la poitrine et à le connecter à un mince câble électrique, pour stimuler le nerf vague gauche au niveau du cou. Ce traitement réversible peu invasif est facilement combinable à un traitement médicamenteux. Il présente d’ailleurs un taux d’observance du patient à long terme plus élevé que la prise de médicaments anti épileptiques.
L’épilepsie en chiffres
• En France, on recense entre 300 000 et 500 000 patients souffrant d’épilepsie. C’est la deuxième maladie neurologique en termes de fréquence.
• Une personne atteinte d’épilepsie est deux à trois fois plus encline à mourir prématurément.
• En Europe, le nombre estimé de nouveaux cas par an est de 130 000 chez les enfants et adolescents, de 96 000 chez les adultes de 20 à 64 ans.
Les électrodes au service des patients pharmaco-résistants
L’épilepsie est un trouble du cerveau se caractérisant par des crises ou convulsions récurrentes, provoquant des changements de comportement ou des troubles de l’attention. L’intervention thérapeutique la plus courante consiste à administrer des médicaments antileptiques. Mais environ 30 % des patients y sont réfractaires : ils sont pharmacorésistants. Plusieurs méthodes chirurgicales sont pratiquées pour soigner l’épilepsie. Celles-ci s’avèrent particulièrement délicates car elles ne doivent pas entraîner de dommages dans les zones fonctionnelles environnantes responsables du langage ou de la motricité. Le succès de la chirurgie est donc intrinsèquement lié à la qualité des investigations préopératoires qui reposent notamment sur l’enregistrement des crises avec des électrodes intracérébrales réalisé grâce à l’électroencéphalogrammes vidéo. La qualité des informations recueillies par de telles électrodes profondes est supérieure à la qualité des informations obtenues par les électrodes collées sur la peau. En outre, la SEEG permet de réaliser des stimulations dans le cerveau pour reproduire tout ou partie des crises afin de localiser précisément les zones impliquées dans les crises.
4. Diagnostic - Un nouvel outil pour la détection précoce des neuropathies
Un nouvel outil pour la détection précoce des neuropathies
Depuis 2009, une nouvelle technologie rapide et non invasive destinée à évaluer la fonction sudorale au niveau des mains et des pieds permet de mettre en évidence une altération des petites fibres nerveuses, signe d’une neuropathie précoce. A l’heure où la prévention est vantée par toutes les institutions sanitaires, ce dispositif innovant attire l’attention.
En matière d’innovation, l’Hexagone n’est pas en reste. C’est en effet une entreprise française qui a inventé, en 2005, un appareil permettant de détecter les neuropathies testant la fonction sudorale (sueur) au niveau des mains et des pieds. Non invasif, cet examen vise à mettre en évidence une altération des petites fibres nerveuses, signe d’une atteinte neuropathique précoce. Ce dispositif innovant est utilisé par les neurologues ou les diabétologues chez des patients diabétiques (le cas le plus fréquent) ou atteints de la maladie de Fabry, d’amylose ou d’autres maladies neurologiques. Le dispositif est constitué d’électrodes en contact avec la plante des pieds et la paume des mains et d’une unité centrale comprenant un logiciel permettant d’interpréter les mesures.
L’analyse du dysfonctionnement des petites fibres nerveuses pour l’évaluation des neuropathies diabétiques est préconisée depuis longtemps, notamment par l’Association Américaine du Diabète (ADA). Medicare, le programme de couverture de sécurité sociale mis en place par le gouvernement américain, reconnaît également l’importance de détecter les neuropathies autonomes liées aux fonctions sudorales tant au regard de l’efficacité de la santé que du coût économique. Mais les techniques traditionnelles (tels le monofilament ou le Quantitative Sudomotor Axon Reflex Test, QSART) restent longues et inconfortables pour le patient, ce qui empêche leur utilisation dans la pratique courante. Elles sont aussi parfois non quantitatives et non reproductibles. C’est pourquoi la stimulation des glandes sudorales est jugée intéressante. Non invasive, rapide, non douloureuse, reproductible, elle ne nécessite ni prise de sang, ni préparation, ni jeûne, ce qui rend l’examen bien plus confortable pour le patient. Les premières machines ont été commercialisées en 2009. Ces différentes étapes lui ont valu d’être qualifiée par des chercheurs suisses, dès 2011, d’« outil prometteur ».
5. Diagnostic - L’oculométrie
L’oculométrie, un dispositif innovant au service du diagnostic
Observer les mouvements des yeux pour détecter les maladies neurologiques ou psychiatriques : tel est l’objectif de ce dispositif récent et particulièrement innovant appelé oculométrie ou eye-tracking. Facile et rapide, ce test sert notamment à améliorer le diagnostic précoce de pathologies difficilement décelables.
Issue de l’ophtalmologie et des sciences cognitives, l’oculométrie s’applique aussi à la neurologie. Elle permet de tester le fonctionnement de régions spécifiques du cerveau grâce à l’analyse des mouvements des yeux et de la tête selon des algorithmes. Elle aide ainsi au diagnostic précoce de maladies neurologiques et psychiatriques ainsi que des troubles de la lecture comme la dyslexie•G.
L’oculométrie est une caméra enregistrant le mouvement des yeux et qui est fixée sur un casque, lui-même relié à un ordinateur sur lequel sont projetés des tests d’oculométrie. Le logiciel effectue un examen du temps de réaction de l’œil, de la vitesse et de la précision sur la cible que le médecin doit ensuite interpréter.
En 2001, Serge Kinkingnehun, chercheur en imagerie médicale à l’Hôpital de la Pitié-Salpétrière (Paris) étudiait les IRM dans le cadre de la maladie d’Alzheimer. Il fut sollicité par des neurologues et des psychiatres pour mettre au point des tests informatisés fonctionnant automatiquement. Il découvrit une méthode développée par des confrères sur le travail des yeux au moyen d’électrodes fonctionnant grâce à une barre de diodes. Son équipe lui demanda alors de concevoir une version modernisée de ce dispositif. Il remplaça donc les électrodes par une caméra et la barre de diodes par des écrans d’ordinateur. L’analyse était automatisée et les mouvements oculaires enregistrés alors qu’ils étaient auparavant imprimés puis analysés avec une règle et un crayon. En 2007, Serge Kinkingnehun décrocha la bourse Charles-Foix qui lui permit de mener une nouvelle étude sur le syndrome parkinsonien. Grâce à d’autres aides, il poursuivit ses recherches et conçut plusieurs d’appareils.
6. Neurovasculaire - Neuroradiologie interventionnelle
L’essor de la neuroradiologie interventionnelle
La neuroradiologie interventionnelle est une approche thérapeutique en pleine expansion. Efficace, fiable et mini-invasive, elle permet de diminuer le coût de la prise en charge du patient tout en augmentant son confort.
La neuroradiologie interventionnelle est la combinaison de l’utilisation des systèmes d’imagerie avec différents dispositifs médicaux insérés dans les artères cérébrales pour diagnostiquer et traiter les malformations vasculaires du cerveau, de la moelle épinière ainsi que certains Accidents vasculaires cérébraux (AVC) notamment ischémiques•G dans leur phase aiguë. Elle permet d’atteindre une cible sous contrôle d’un examen d’imagerie (échographie, scanner etc.) via les vaisseaux ou les voies naturelles ou à travers la peau à l’aide d’une fine sonde.
Un traitement de neuroradiologie interventionnelle est réalisé en passant par l’artère fémorale (cuisse), au niveau du pli de l’aine, différents cathéters (minuscules tuyaux) étant dirigés vers le cerveau. Cette procédure évite donc l’incision chirurgicale au niveau de la boite crânienne. Le guidage depuis l’aine jusqu’au cerveau se fait sous contrôle des rayons X. Plusieurs techniques sont ensuite possibles pour traiter la pathologie neurologique anévrismale : la mise en place dans l’anévrisme de coils ou l’utilisation de stents•G associés aux coils ou l’utilisation de stent Flow Diverter mis en place avec ou sans coils.
Le concept de radiologie interventionnelle s’inscrivit dans la pratique médicale en 1963 lorsque le radiologue américain Charles Dotter montra qu’un cathéter introduit dans le système vasculaire jusque-là uniquement utilisé à visée diagnostique, pouvait constituer une solution thérapeutique. Fruit d’une collaboration entre neurochirurgiens et neuroradiologues, la neuroradiologie interventionnelle apparut dix ans plus tard avec les premières embolisations vasculaires sous angiographie•G réalisées par le Français René Djindjian et le radiologue américain Sidney Wallace. En offrant une alternative à la neuro-chirurgie qui nécessite une ouverture du crâne, cette pratique a révolutionné la discipline. Elle devint d’autant plus rapidement l’un des piliers de la radiologie interventionnelle par voie endovasculaire•G qu’elle ne cessa de se perfectionner : la technique du stenting par cathéter apparut en 1969 suivie par les premières occlusions par coils dans les années soixante-dix. Son essor alla également de pair avec le développement de l’imagerie grâce, notamment, à l’invention du scanner, de l’échographie et de l’IRM qui permirent d’améliorer considérablement le guidage des praticiens.
Vers le remplacement de la neurochirurgie ?
Selon la Société Française d’Anesthésie et de réanimation (Sfar), « depuis les années deux mille, les indications de la neuroradiologie interventionnelle se sont considérablement accrues ». Cela est dû à « la qualité du matériel radiologique et informatique qui permet l’acquisition et le traitement des images ainsi que des nombreux types de cathéters et de matériels d’embolisation disponibles ». Pour Jacques Moret, chef du service de neuroradiologie interventionnelle à l’Hôpital Beaujon de Clichy (Hauts-de-Seine), le traitement endovasculaire constitue à coup sûr l’avenir : « Avec cette technique, il n’y a plus aucune limite à l’accès aux artères cérébrales alors que, dans les années soixante-dix, nous devions nous arrêter à la carotide ! ». Le succès est tel qu’aujourd’hui, cette thérapeutique, longtemps réservée aux cas désespérés, remplace de plus en plus souvent la neurochirurgie pour traiter les anévrismes intracrâniens, indique le professeur Alain Bonafé, coordinateur du département de neuroradiologie au CHRU de Montpellier et président de la Société Française de Neuroradiologie (SFNR). Toutes les localisations sont en effet aujourd’hui accessibles bien que certaines formes d’anévrisme (larges, géants…) demeurent difficiles d’accès.
Capteurs plan : l’image dématérialisée
Un nouvel appareil est apparu il y a quelques années dans le domaine de la radiologie : le capteur plan, boîtier grâce auquel on peut obtenir une image numérisée de haute définition dès la réalisation d’une radiographie. Ce dispositif est constitué d’une matrice de pixels active capable de convertir les rayons en signaux électriques et en données numériques. La dose de rayons X utilisée peut être diminuée de moitié pour des résultats identiques à la radiologie conventionnelle sinon meilleurs. Cette nouvelle technologie, d’abord acquise à la cardiologie, s’étend peu à peu à la neuroradiologie interventionnelle. Elle offre en effet gain de temps considérable dans la réalisation d’examens standard, un critère non négligeable à l’heure où les profondes modifications du système de gestion hospitalier imposent d’optimiser les coûts de fonctionnement dont le montant est souvent très supérieur à celui des coûts d’investissement.
7. Neurovasculaire - Implants d’embolisation artérielle
Implants d’embolisation artérielle : des dispositifs indispensables à la radiologie interventionnelle
Pratique courante en radiologie interventionnelle, la technique d’embolisation consiste à obstruer une artère en lui injectant un produit ou un dispositif afin d’en empêcher le dysfonctionnement d’une artère ou la prolifération d’une pathologie.
L’embolisation consiste à boucher l’anévrisme par l’intérieur des vaisseaux. Le médecin pique au niveau de l’aine dans l’artère fémorale ou dans l’artère humérale (coude) pour y introduire un cathéter qu’il mène jusqu’à la malformation en s’aidant des images fournies en direct par imagerie. Puis, il injecte dans cette malformation le produit actif. En fonction du type de malformation et de sa localisation, deux types d’implants sont introduits : des produits solides tels les coils (petites spires métalliques) ou des billes (microparticules) ; ou bien des produits liquides ou semi-liquides tels de la colle biologique ou d’éthanol. Dans le domaine neurovasculaire, l’embolisation des anévrismes intracrâniens, soit avant qu’ils ne se rompent, soit lorsqu’ils sont rompus, a presque remplacé la neurochirurgie.
Les pratiques d’embolisation existaient déjà dans les années trente. Elles étaient alors réalisées avec du muscle, de la graisse ou des morceaux de fascia latta (large bande fibreuse). Trente-huit ans plus tard, on commença à utiliser des caillots sanguins autologues (cellules, tissus) pour traiter les malformations artérioveineuses spinales (nerfs responsables de la motricité ou de la sensibilité des membres, des sphincters et du périnée). Ils présentent l’avantage d’être biocompatibles mais leur effet est limité dans le temps. Parallèlement, les neurologues commencèrent à utiliser la soie et la dure-mère comme agents embolisants chez des patients que l’on ne pouvait traiter avec la chirurgie. Ces produits furent remplacés, dans les années soixante-dix, par de nouveaux types d’agents d’occlusion : les Particules d’Alcool Polyvinyle (PVA), la colle, les spires (coils) et les plugs.
Les progrès des implants endovasculaires et des microcathéters ont permis, au cours de ces quinze dernières années, le développement considérable de la Neuroradiologie Interventionnelle (NRI). Ce traitement des malformations vasculaires du cerveau grâce aux systèmes d’imagerie a supplanté le traitement neurochirurgical classique pour de nombreux cas et est devenu une spécialité clinique à part entière. Il permet en effet d’éviter les complications qui affectent le système nerveux et les enveloppes de la face, lesquelles peuvent mettre en jeu le pronostic vital.
8. Neurovasculaire - Les coils
Les coils, une alternative à la chirurgie
Apparue dans les années quatre-vingt-dix, la pose de coil, petit implant métallique permettant de remplir les anévrismes cérébraux, s’impose face à la chirurgie.
Le coil est un implant métallique allongé constitué d’un alliage thrombogène à base de fils de platine. Une occlusion endovasculaire (c’est-à-dire à l’intérieur d’un vaisseau sanguin) par coil est pratiquée pour traiter les anévrismes cérébraux, principalement ceux à collet étroit.
La technique de coiling consiste à obstruer complètement le sac anévrismal par l’intérieur en y introduisant un ou plusieurs coils. Un cathéter est alors introduit dans l’artère fémorale : il sert de guide pour monter une sonde endovasculaire très fine sur laquelle est attachée le coil. L’anévrisme est alors rempli de coils pour le boucher complètement et ainsi éviter le saignement. Les coils peuvent être largués de différentes façons selon leur type : électrolyse, mécanique ou hydraulique. Cette procédure s’effectue sous anesthésie générale et nécessite une anticoagulation efficace afin d’éviter la formation de thrombus (caillot) lors des actes endovasculaires. « Le coil fait partie de ces dispositifs médicaux établis en neurologie. Il y a eu des progrès constants depuis leur apparition dans les années quatre-vingt-dix. Aujourd’hui, ils représentent environ 70 % des traitements des anévrismes », explique Alain Bonafé, coordinateur du département de neuroradiologie au CHU de Montpellier. Il existe aujourd’hui des coils de calibre, de diamètre, de forme, de souplesse et de longueur variables. Cette variété de types de détachement permet de vérifier et de modifier leur position dans le sac anévrismal voire de le retirer s’il s’avère que le coil choisi n’est pas adéquat.
Un nouveau traitement pour les anévrismes à collet large et géant
Si cette technique constitue aujourd’hui celle de référence pour le traitement des anévrismes intracrâniens, elle présente néanmoins un certain nombre de limitations, notamment dans le traitement des anévrismes à collet large mais aussi des anévrismes larges et géants. C’est dans ce contexte qu’est arrivé sur le marché, en 2013, un nouveau dispositif de haute technologie : la cage intra-anévrismale, pour traiter les anévrismes de bifurcation à collet large. Ces minuscules cages de titane tissé sont implantées directement dans la poche de l’anévrisme grâce au guidage d’un cathéter à partir de l’artère fémorale. « Elles présentent l’avantage de s’adapter parfaitement à l’anévrisme dont le volume a été calculé par une série de scanners et d’IRM », indique Alain Bonafé.
9. Neurovasculaire - Le stent
Le stent, un outil au service du traitement endovasculaire
Ce petit ressort métallique est un dispositif médical utilisé dans le cas d’angioplasties. Cette procédure permet d’intervenir et de réparer une lésion par l’intérieur de l’artère (voie endovasculaire). Une alternative à la chirurgie.
Le stent est un petit dispositif métallique et cylindrique ressemblant à un ressort, placé dans la partie rétrécie d’une ou de plusieurs artères, pour rétablir une ouverture normale et ainsi assurer une bonne circulation du sang. Il est notamment utilisé pour traiter le rétrécissement de l’artère carotide interne (située dans le cou, elle vascularise le cerveau) dans le cas d’une opération appelée angioplastie, qui vise à réparer l’artère par l’intérieur, sans opération chirurgicale. Cette technique est pratiquée pour traiter les lésions des artères carotides non accessibles à la chirurgie mais aussi les sténoses de patients présentant un état cervical défavorable ou à haut risque cardiovasculaire. Les stents sont également indiqués pour traiter certains anévrismes intracrâniens difficiles à prendre en charge par les méthodes de traitement habituelles.
Suite à la publication de l’étude ISAT en 2002 (voir sources), le traitement endovasculaire devint la première approche thérapeutique dans la prise en charge des anévrismes intracrâniens. Celui-ci consista d’abord principalement à mettre en place des spirales métalliques (coils) au sein de la poche anévrismale. « Des techniques se développèrent ensuite, notamment pour le traitement de certains anévrismes à l’anatomie complexe, par exemple à collet large : la technique de remodeling » indique l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (ANSM). C’est dans ce contexte qu’apparut, en 2003, un traitement associant stents et coils grâce à la mise sur le marché de nouveaux stents intracrâniens ne mesurant que quelques millimètres. Contrairement aux stents coronaires qui sont déployés dans les artères à l’aide d’un cathéter à ballon, ces petits ressorts sont plus souples et auto-expansibles. Autrement dit, on les fait coulisser à l’intérieur d’un cathéter et ils se déploient automatiquement dès leur sortie du dispositif.
Une utilisation fréquente pour traiter les anévrismes
En juillet 2010, un nouveau stent intracrânien a été commercialisé aux États-Unis et en Europe pour traiter les anévrismes intracérébraux à large collet en complément de coils. Flexible et très stable pour s’adapter à la tortuosité de l’anatomie cérébrale, ce dispositif peut être placé par un seul praticien et ainsi simplifier les procédures neurovasculaires complexes. « Le 17 avril 2015, le New England Journal of Medecine a validé un nouveau dispositif : le stent de thrombectomie, aussi appelé stent-retriever, associant la thrombectomie (lire page 19) mécanique et l’extraction d’un caillot avec un stent », indique Alain Bonafé, coordinateur du département de neuroradiologie au CHRU de Montpellier. Cette technique de revascularisation cérébrale est considérée comme particulièrement efficace car elle évite les complications hémorragiques comparativement à la thrombolyse intraveineuse seule.
10. Neurovasculaire - Le flow diverter
Le flow diverter, un nouveau traitement pour traiter les anévrismes intracrâniens
Stents à mailles serrées, les flow diverters existent depuis les années deux mille. Ce dispositif sert à soigner les anévrismes non rompus et ceux à collet large. Il est néanmoins récent en pratique clinique et nécessite d’être confirmé par des études en cours.
Les flow diverters sont conçus pour traiter les anévrismes non rompus à col large complexes et les anévrismes rompus. Ils sont préconisés lorsque les traitements endovasculaires sont impossibles ou présentent un risque de morbi-mortalité important.
Ce dispositif d’embolisation est composé d’un implant permanent, un cylindre tressé en maillage composé d’alliages multiples (platine/tungstène et cobalt/chrome/nickel) associé à un système de mise en place basé sur un fil guide. Il est mis en place à l’aide d’un micro-cathéter et peut être utilisé seul ou en association avec des microspires. Grâce à son maillage trois fois plus dense que le stent traditionnel, il redirige le flux sanguin de manière plus importante dans l’artère porteuse et perturbe le flux sanguin intra-anévrismal conduisant à la formation d’un thrombus.
Le traitement endovasculaire des anévrismes intracrâniens par coïling est la référence depuis 2002. Néanmoins, en dépit de nombreuses améliorations, cette technique est parfois mise en défaut, notamment dans le cadre d’anévrismes géants à collet large pour lesquels le risque de recanalisation est important. Dans ce contexte, l’arrivée, début 2008, des flow diverters, grâce à l’évolution technologique des stents, a « constitué un véritable changement de paradigme, permettant d’envisager une reconstruction du segment artériel plutôt qu’une simple occlusion de la poche anévrismale », selon une étude française réalisée en 2014.
Les flow diverters sont de plus en plus utilisés pour la prise en charge des patients. En Europe, cinq dispositifs de ce genre sont aujourd’hui référencés dans le traitement des anévrismes intracrâniens. Mais la survenue de complications (ruptures retardées des anévrismes traités), voire le décès de patients, notamment au Royaume-Uni, a amené l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (ANSM) et la Société Française de Neuroradiologie (SFNR) à mener une réflexion sur les conditions d’accompagnement de l’utilisation de cette technique.
Depuis 2010, l’ANSM exerce une surveillance particulière de ces dispositifs et demande aux professionnels concernés de contribuer à l’amélioration des connaissances sur ceux-ci. Conditions de pose, traitements associés, suivi des patients… Depuis 2012, un registre « Diversion » a été mis en place par la SFNR pour recenser toutes les poses de Flow Diverter réalisées en France et recueillir le maximum de données concernant les types d’anévrismes traités et les suites opératoires observées à court et moyen termes.
11. Neurovasculaire - Thrombectomie mécanique
Thrombectomie mécanique : une perspective d’avenir pour les AVC
Réalisée par voie endovasculaire par un neuroradiologue interventionnel, la thrombectomie mécanique représente une perspective thérapeutique intéressante pour les accidents vasculaires cérébraux ischémiques aigus, lesquels sont un enjeu de santé publique est important.
La thrombectomie mécanique est une technique utilisée pour traiter les Accidents vasculaires cérébraux ischémiques (AVCi) les plus graves, provoqués par un caillot de sang qui bloque un vaisseau sanguin dans le cerveau. Cette pathologie est la conséquence du manque d’apport d’oxygène dans une partie du cerveau et peut être due à une thrombose (occlusion) de la carotide interne ou à une embolie (migration d’un caillot ou d’un débris de dépôt graisseux) cérébrale à partir d’une sténose carotidienne. Sans traitement en urgence, près de la moitié des patients seraient gravement handicapés car l’AVC provoque la mort de nombreuses cellules nerveuses, entraînant ainsi des troubles moteurs, sensoriels et cognitifs, voire la paralysie. L’AVC présente un véritable enjeu de santé publique dans les pays occidentaux où il est la première cause de handicap acquis de l’adulte, la deuxième cause de démence et la troisième cause de mortalité.
La thrombectomie mécanique consiste à aller chercher le caillot sanguin responsable de l’AVC directement dans le cerveau grâce à une série artériographique avec injection de produit de contraste iodé dans le cathéter afin de préciser le niveau et le degré de l’occlusion intracrânienne. Un micro-cathéter de petit calibre est inséré dans un cathéter porteur jusqu’au contact ou au-delà du thrombus. C’est là qu’est réalisée la thrombectomie.
« La première thrombectomie a été rapportée par le neurologue Carlos Castano dans l’Interventional Neuroradiology, en 2009. Mais, depuis lors, c’est l’Hôpital Gui de Chauliac, à Montpellier, qui a été précurseur dans ce domaine », relate Alain Bonafé, coordinateur du département de neuroradiologie au CHRU de Montpellier. Depuis 2008, plusieurs dispositifs de thrombectomie par voie endovasculaire ont en effet été développés. De plus en plus utilisé, ce nouveau traitement intra-artériel est préconisé en cas de contre-indication ou d’inefficacité de la fibrinolyse systémique•G , le traitement de première intention recommandé en cas d’AVC. Il constitue une approche thérapeutique intéressante car il cause moins de dommages cérébraux irréversibles et donc de problèmes neurologiques et de handicap dans la vie quotidienne. En outre, il est favorisé par l’utilisation de plus en plus largement répandue des stents dont la mise en place est rapide et relativement aisée. Dès 2009, une première étude, intitulée « Recanalise », a montré que l’association fibrinolyse IV/thrombectomie permet d’obtenir une recanalisation artérielle dans 87 % des cas et est donc significativement plus efficace que la fibrinolyse IV seule (52 % de recanalisation). Elle notait également une amélioration clinique immédiate évaluée pour 60 % des patients (contre 39 % pour la fibrinolyse IV seule).
Une meilleure récupération, plus vite, pour les patients
Une étude publiée en décembre 2014 dans le New England Journal of Medicine et lors du World Stroke Congress d’Istanbul (Turquie) a montré qu’une majorité des patients ont plus de chances de récupérer mieux et plus vite si le vaisseau, bloqué par un caillot, est rouvert rapidement en utilisant un dispositif médical qui permet de se saisir du caillot et de l’extraire à travers un cathéter. Ainsi, les chances de récupération des patients passent à plus de 30 %, contre 19 % avec la thrombolyse. Néanmoins, cette étude n’a pas apporté de preuve que le traitement réduise le risque de décès. Des études contrôlées, randomisées et multicentriques sont actuellement menées en France et aux États-Unis, lesquelles permettront de valider avec un haut niveau de preuve l’efficacité et la sécurité de la thrombectomie mécanique.
À savoir
La thrombectomie en France
• 32 centres réalisent cette intervention.
• Selon le Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information (PMSI), 4 000 candidats à thrombolyse seraient susceptibles d’être traités.
12. Techniques stéréotaxiques - Radiothérapie stéréotaxique robotisée
Radiothérapie stéréotaxique robotisée : une technologie toujours plus précise
La radiothérapie stéréotaxique est un type de radiothérapie externe permettant de diriger des faisceaux de radiation vers une région très spécifique, en particulier le cerveau.
Cette technique de haute précision est basée sur l’utilisation de microfaisceaux convergents permettant d’irradier à haute dose des zones à soigner. Elle peut être réalisée à l’aide d’une machine dédiée ou avec un accélérateur linéaire. Ce type de radiothérapie externe en trois dimensions permet de diriger des faisceaux de radiation vers une région très spécifique. Elle est utilisée pour traiter les tumeurs difficiles à atteindre ou que l’on ne peut pas retirer chirurgicalement car cela causerait des dommages à un trop grand nombre de tissus sains du cerveau. Elle est aussi indiquée pour traiter une récidive et des métastases•G au cerveau. Dans certains cas, cette dose peut toutefois être délivrée en une seule fois : la séance unique de radiothérapie est alors qualifiée de radiochirurgie stéréotaxique.
Un cadre de stéréotaxie (sorte d’anneau enfermant la tête et dont le but est de stabiliser les patients pour récupérer des informations sur le cerveau) est fixé sur le crâne au bloc opératoire, après anesthésie locale. Une IRM est ensuite réalisée par un radiologue afin de visualiser le cerveau en trois dimensions. Et de permettre au physicien et au radiothérapeute de définir les modalités du traitement et de calculer la trajectoire exacte des rayons pour encercler la tumeur, le dosage et le type de rayons à utiliser. Le traitement proprement dit peut ensuite commencer : le patient est allongé sur une table à laquelle le cadre est fixé pour empêcher tout mouvement lors de l’irradiation. Les faisceaux d’irradiation sont réglés selon les positions déterminées précédemment. L’irradiation est alors lancée : la séance dure entre 20 et 60 minutes et est complètement indolore.
La neurochirurgie stéréotaxique fut conçue comme méthode d’expérimentation animale des structures cérébrales profondes par Horsley et Clarke il y a plus de cent-trente ans, puis développée chez l’homme au lendemain de la Seconde Guerre mondiale comme méthode chirurgicale destinée à la neurochirurgie fonctionnelle. On l’utilisa ensuite comme méthodologie d’exploration et de traitement de nombreuses pathologies cérébrales, lésionnelles et fonctionnelles. L’irradiation cérébrale par mini faisceaux en conditions stéréotaxiques apparut finalement en 1951 grâce aux travaux du neurochirurgien et physicien suédois Lars Leksell. Le Français Jean Talairach apporta une contribution majeure à cette jeune discipline en publiant, en 1957, un atlas des coupes cérébrales dans lequel il souligna la nécessité d’avoir au moins deux repères intracérébraux comme références.
Ce système de coordonnées cérébrales permit de repérer la position de n’importe quel point dans le cerveau d’un individu. L’avènement du scanner dans les années soixante-dix et de l’informatique individuelle grâce à l’invention de micro-ordinateurs personnels, puis l’apparition de l’IRM en 1986 permirent de simplifier l’utilisation de cette technique.
Dans les années quatre-vingt-dix, les applications s’élargirent aux actes chirurgicaux d’exérèse•G , notamment tumorales, en assurant une ouverture crânienne limitée et un contrôle interactif des gestes. En 1987, le Professeur de neurochirurgie et de radiothérapie John Adler mit au point un système de radiochirurgie robotisée permettant non plus seulement de traiter les tumeurs intracrâniennes mais toutes les tumeurs, cancéreuses ou non, dans tout le corps (cerveau, rachis, poumon, prostate, etc.), par l’administration d’une dose élevée de rayons sous forme de faisceaux avec une grande précision. Ce dispositif intelligent et infiniment précis constitue le premier système de radiochirurgie commercialisé qui associe guidage par imagerie et robotique assistée par ordinateur. Il présente l’avantage de ne pas nécessiter de cadre stéréotaxique invasif pour stabiliser les mouvements du patient.
En 1994, en Californie, le premier patient fut traité puis le dispositif fut homologué aux États-Unis dans les années deux mille, d’abord pour le traitement des tumeurs intra et extracrâniennes puis pour le traitement des tumeurs de la tête, du cou et de la partie supérieure de la colonne vertébrale. Il fallut néanmoins attendre 2003 pour qu’il soit utilisé en Europe.
En 2004, le développement de nouveaux algorithmes combiné à l’informatique modernisa le robot qui bénéficia dès lors d’une synchronisation à la respiration. Cela signifie que le robot suit la lésion et corrige son tir de rayons en temps réel, y compris lorsque la personne bouge : en respirant ou de façon imprévisible à cause de l’activation de fonctions physiologiques.
Ce dispositif ultramoderne présente de nombreux avantages : moins invasif, il est aussi particulièrement précis (de l’ordre de l’infra-millimétrique !), ce qui limite les complications et les dommages collatéraux des tissus voisins. Il permet également de traiter les patients en ambulatoire et réduit la durée de convalescence. En France, dix centres sont aujourd’hui équipés de telles machines.
La radiochirurgie robotisée en chiffres
Plus de 300 systèmes de radiochirurgie robotisée sont installés dans le monde. Chaque machine traite en moyenne entre 300 et 400 patients par an : environ 1 million de patients sont donc pris en charge chaque année.
13. Techniques stéréotaxiques - Salles hybrides
Salles hybrides : la révolution mini-invasive
Fruit du développement de la chirurgie interventionnelle et des progrès de l’imagerie médicale, la salle hybride constitue l’un des plateaux techniques les plus modernes. Cette technologie représente un espoir majeur pour les opérations neurochirurgicales les plus délicates.
La salle hybride permet aux chirurgiens de réaliser en un seul temps plusieurs traitements sur le même patient mais aussi d’obtenir une visualisation radiologique en temps réel et d’offrir une meilleure sécurité opératoire. Ce plateau technique moderne rend donc possible les interventions sous coelioscopie sur les vaisseaux autrefois réalisées sous chirurgie lourde. Il suffit désormais d’une légère incision et d’une anesthésie courte, les suites opératoires réduites autorisant le patient à regagner son domicile le soir même. Cette technologie est utilisée en urgence pour traiter les hémorragies graves (post partum, polytraumatisé, ...) ou en semi-urgence pour pratiquer la fibrinolyse (dissolution d’un caillot sanguin) afin de désobstruer des pontages vasculaires périphériques ou d’artères natives. Elle est également recommandée pour l’embolisation des fibromes•G.
Une salle hybride combine un bloc opératoire destiné aux interventions cardiaques (chirurgie mini-invasive) et une salle de radiologie. Elle est donc équipée d’un robot d’imagerie interventionnelle que le chirurgien peut déplacer au cours de l’opération mais aussi d’une table réorientable, de commandes adaptées et d’écrans de part et d’autre du patient afin que les professionnels puissent mieux se mouvoir.
C’est au centre Cardio-Thoracique de Monaco (CTM) que sont nées les salles hybrides, dans les années deux mille. En France, l’unité de chirurgie cardiaque de l’Hôpital Privé Jacques Cartier à Massy (Île-de-France) a été la première à s’équiper de cette technologie en 2010. La motivation était forte car ce nouveau dispositif présente des avantages importants : meilleure sécurité, qualité d’image supérieure, outils de guidage plus performants, précision affinée, gestes surveillés de manière plus optimale, temps d’acquisition plus rapide et confort de travail pour le médecin et le chirurgien. Que de promesses ! En outre, grâce au ciblage précis des zones anatomiques, les doses de radiation sont diminuées de 50 %. Surtout, les équipes sont en mesure de visualiser les zones opérées en 3D, de reconstruire et de fusionner des images afin de vérifier en temps réel l’efficacité de leurs gestes sur le patient. Performance technique et gain de temps se combinent donc tandis que l’on évite au patient l’habituel examen radiologique de contrôle. Enfin, le dispositif permet grâce au système de vidéotransmission (caméra et écrans), un enseignement en direct ou différé et à distance à destination de l’ensemble de l’équipe et des professionnels en formation. C’est pourquoi les salles thérapeutiques sont aujourd’hui envisagées comme des leviers d’excellence thérapeutique pour l’hôpital. A tel point que la création des salles hybrides connaît une progression très importante : une vingtaine de projets naissent chaque année. Cela constitue une rupture majeure avec la salle interventionnelle d’il y a vingt ans, laquelle utilisait un amplificateur de brillant (aussi appelée capteur-plan) pour obtenir instantanément une image radiologique numérique de haute définition dès la prise du cliché radiographique.
Cette technologie a élargi le spectre des traitements en prenant en charge les malformations artérioveineuses, pelote de vaisseaux sanguins constituée de veines et d’artères pouvant provoquer une hémorragie cérébrale. Les trois quarts environ des cas peuvent être opérés mais les autres malformations sont situées si profondément, sont si volumineuses ou d’accès tellement difficile qu'il n’est pas possible d'opérer sans provoquer de dégâts importants. Les salles hybrides permettent aujourd’hui, grâce aux outils 3D, de visualiser cette malformation pour mieux la caractériser et ainsi faire un choix thérapeutique plus éclairé.
Quid de l’avenir pour un matériel si récent ? Selon les experts, il s’agit aujourd’hui d’améliorer les outils de guidage afin qu’ils soient toujours plus précis et que l’on émette une dose minimum de rayons X. Des problématiques d’intégration seront également évaluées, concernant notamment la fusion des techniques (échographie avec image radio, outils de guidage et repérage dans l’espace, etc.) en misant sur une définition toujours fine et une mise au point de plus en plus rapide. Enfin, les améliorations passeront également par la mise au point de cathéters et de stents encore plus performants et plus petits.
14. Neurostimulation - Une méthode novatrice
La neurostimulation, une méthode novatrice
La neurostimulation a révolutionné la prise en charge de certaines affections comme la maladie de Parkinson. Elle constitue aujourd’hui un traitement particulièrement prometteur.
La neurostimulation sert à traiter les pathologies pour lesquelles il n’existe pas de traitements satisfaisants ou suffisamment efficaces. Elle est utilisée dans les cas de maladie de Parkinson et d’Alzheimer ou encore d’épilepsie pharmaco-résistante, mais aussi de douleurs chroniques. Elle est également envisagée dans le traitement de certaines formes de dépressions résistantes aux traitements, des TOC (Troubles Obsessionnels Compulsifs), des troubles du comportement alimentaire (comme l’anorexie mentale) ou encore pour traiter des cas d’addiction sévère. Peu agressive, elle est aussi réversible et présente peu de risques.
La neurostimulation consiste à stimuler en permanence une zone enfouie profondément dans le noyau subthalamique•G du cerveau. Pour ce faire, sans ouvrir la boite crânienne, une à quatre très fines électrodes sont implantées grâce à une technique de repérage stéréotaxique pilotée par IRM. Un câble très fin est situé sous la peau pour relier les électrodes à un neurostimulateur placé sous la peau, au niveau de la clavicule. Ce stimulateur transmet un courant électrique dans les électrodes afin de stimuler la région du cerveau impliquée dans la survenue des troubles. Dans le cas de la maladie de Parkinson, par exemple, le courant électrique corrige les effets de l’insuffisance en dopamine•G caractéristique de la maladie de Parkinson, réduisant ainsi les dysfonctionnements moteurs.
« À l’exception du programmateur de thérapie, tous les composants du dispositif sont à l’intérieur du corps. Le neurostimulateur peut se manifester sous la forme d’un petit renflement sous la peau mais, le plus souvent, il passe totalement inaperçu sous les vêtements. Le patient peut garder le dispositif de nombreuses années même s’il faut changer la pile sous anesthésie locale au maximum tous les cinq ans », explique Patrick Mertens, chef de service en neurochirurgie au CHU de Lyon.
On trouve des témoignages anciens de l’utilisation de l’électricité dans le traitement de la douleur, relate le Professeur de neurochirurgie Yves Lazorthes dans un article intitulé « Evolution de la prise en charge de la douleur dans l’histoire de la médecine ». « Si l’usage des chocs électriques produits par les poissons électriques, et notamment un poisson torpille, semblait déjà connu dans l’Egypte ancienne, c’est durant le premier siècle après Jésus-Christ que Scribonius Largus rapportera le soulagement d’une douleur articulaire survenu accidentellement chez un patient lors d’un bain de mer. Par la suite, de nombreux médecins romains, dont Galien, le préconisèrent pour traiter certaines douleurs et en particulier celles de la goutte ». Puis cette technique fit son retour au XIXe siècle avec le développement de l’électroanesthésie. « Les premières techniques de neurostimulation comme traitement des douleurs chroniques se développèrent à la suite de la publication du psychologue Ronald Melzack et du physiologiste Patrick Wall, en 1965 sur la théorie des Gate control (lire encadré page 27), portant sur l’influence des voies sensitives non douloureuses sur la perception de la douleur », indique Patrick Mertens. Ils systématisèrent la technique de neurostimulation électrique transcutanée, consistant à soulager la douleur en stimulant des nerfs périphériques à l’aide d’un courant électrique de faible tension transmis par des électrodes sur la peau. Deux ans plus tard, Wall, en équipe avec Bill Sweet cette fois, proposa la stimulation médullaire comme traitement de douleurs chroniques. « Melzach et Wall ont montré qu’un système sensitif, tel que la nociception (processus sensoriel à l’origine du message nerveux qui provoque la douleur), pouvait être modulé et que cela permettait de traiter des douleurs par l’application de courants électriques sur les fibres nerveuses qui inhibent ces systèmes. D’où l’idée de poser des électrodes sur la méninge recouvrant la moelle épinière », résume Patrick Mertens. Cette technique permit de traiter des douleurs chroniques d’origine neurologique comme la lésion d’un nerf.
Avènement de la stimulation médullaire
Après la théorie, la pratique. En 1969, le Docteur Norm Shealy effectua la première stimulation médullaire sur un homme, c’est-à-dire sur les cordons postérieurs de la moelle via une électrode implantée. « La neurostimulation médullaire consiste à glisser une électrode entre deux vertèbres dans le canal rachidien, à l’arrière de la moelle épinière. Elle est reliée à un stimulateur sous la peau que le patient peut commander pour régler l’intensité de la stimulation en fonction de la douleur, explique Patrick Mertens. Elle s’adresse à des patients atteints de douleurs chroniques provoquées par la lésion des nerfs (compression, traumatisme, douleur sciatique). Le malade peut garder ce stimulateur le temps nécessaire, parfois plus de dix ans s’il le faut. » Parallèlement, les neurolochirurgiens essayèrent de traiter différents types de douleur en stimulant les nerfs périphériques puis les différentes structures cérébrales profondes et, finalement, le cortex moteur. La stimulation des zones très profondes, au niveau du tronc cérébral, où se trouvent des récepteurs de la morphine, se révéla partiellement efficace, notamment pour soulager les patients atteints de cancer. « Mais elle fut peu utilisée car elle ne fonctionne pas longtemps », précise le Professeur Mertens.
Durant les années quatre-vingt, la stimulation médullaire se développa et la technique se diffusa. « La neurostimulation fut alors utilisée dans d’autres domaines que la douleur : les troubles ischémiques en 1972 et les troubles vesicosphinctériens en 1985 », note Patrick Mertens. En outre, le matériel évolua. « Les piles et les électrodes se miniaturisèrent et le plastique rigide fut remplacé par du silicone souple. Et, grâce à l’électronique, le paramétrage se sophistiqua. » Mais la technique demeurait au stade de la recherche clinique alors que les paramètres administrés étaient déterminés de façon empirique.
SCP : une épopée française
Il fallut attendre le développement de la stimulation dans les années quatre-vingt-dix pour traiter d’autres affections chroniques comme les mouvements anormaux. En 1987, en effet, les Professeurs Alim-Louis Benabid et Pierre Pollak, de l’Hôpital universitaire de Grenoble, publièrent les résultats de la première application de la Stimulation Cérébrale Profonde (SCP) au traitement des troubles du mouvement. Cette technique chirurgicale consiste à introduire des électrodes dans des zones précises et profondes du cerveau. Elle est réservée aux patients sévèrement atteints au point de présenter des répercussions sur la vie sociale et professionnelle. Au départ, dans les années quatre-vingt, elle s’adressa aux patients victimes de tremblements handicapants. Puis, elle fut utilisée sur des sujets atteints de la maladie de Parkinson. Depuis 1997, 80 000 patients à travers le monde ont bénéficié de la thérapie de stimulation cérébrale profonde. Cette invention a révolutionné le traitement de Parkinson.
Si elle ne permet pas de guérir la maladie, la SCP donne des résultats spectaculaires chez les patients atteints du tremblement essentiel. Ils peuvent ainsi souvent reprendre une activité normale. La SCP constitue le traitement de référence contre la maladie de Parkinson à un stade évolué car elle améliore les gestes de la vie quotidienne : la marche, la parole et la posture. Malgré tout, « seulement 5 à 10 % des personnes atteintes de la maladie de Parkinson bénéficient aujourd’hui de la stimulation cérébrale profonde (soit environ 400 patients par an en France) et environ dix fois moins dans les autres indications (tremblements et dystonies) » selon l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm). « Ces chiffres pourraient néanmoins s’étoffer si la technique faisait ses preuves dans des pathologies graves affectant des sujets jeunes sans alternative thérapeutique » telles que l’anorexie mentale, l’une des premières causes de décès des jeunes filles, ou encore les addictions.
Un fort potentiel de croissance
Depuis le début des années deux mille, d’autres applications pour la neurostimulation sont explorées, notamment dans le champ de la psychochirurgie, à destination des patients présentant des troubles psychiatriques qui résistent à la prise en charge classique. Cela concerne notamment le traitement des Troubles Obessionnels Compulsifs (TOC), des patients victimes de dépression sévère ou encore de l’épilepsie. Des essais sont en cours pour valider ces applications. « La neurostimulation a désormais plus de cinquante ans de pratique, conclut Patrick Mertens. Cette technique a permis de développer de nouvelles possibilités de traitement, notamment pour les douleurs chroniques mais elle a aussi montré des résultats spectaculaires dans la prise en charge des mouvements anormaux. Elle est particulièrement intéressante car elle est ajustable et réversible avec une efficacité intéressante pour une morbidité limitée ».
La théorie des portes de douleur
La théorie du gate control a été décrite par Patrick Wall et Ronald Melzack en 1965. Elle explique que le message douloureux est modulé tout au long de son cheminement par des systèmes régulateurs et qu’au niveau de la moelle épinière, il existe un filtre modulateur de très grande importance : la porte. Le message douloureux transite par cette porte et plus la porte est ouverte, plus le message douloureux est perçu comme intense, ce qui explique pourquoi le débit du message douloureux peut être augmenté, réduit, voire interrompu. Cette théorie a permis de comprendre les effets de certaines réactions face à la douleur, comme le fait d’imbiber d’eau fraîche une brûlure, ce qui peut effectivement soulager une douleur en provoquant la fermeture de la porte.
À savoir
Des implants pour récupérer des souvenirs endommagés
Le Defense Advanced Research Projects Agency, l’agence américaine pour les projets de recherche avancée dans le domaine de la Défense, travaille actuellement à la mise au point d’implants cérébraux capables d’aider les soldats qui souffrent de lésions cérébrales traumatiques. Il s’agit d’utiliser des électrodes pour stimuler les tissus endommagés. En outre, l’Agence élabore des neuroprothèses pouvant soigner la dépression et les troubles du stress post-traumatiques grâce à la stimulation magnétique transcrânienne.
15. Neurostimulation - Un traitement
Un traitement de l’incontinence urinaire et fécale
La neuromodulation sacrée permet de traiter l’incontinence urinaire et fécale. Son efficacité thérapeutique peut être appréciée à l’aide d’un test simple. Cette thérapie a révolutionné la chirurgie de l’incontinence.
Utilisée en thérapie de seconde intention, la neurostimulation sacrée a plusieurs objectifs : intervenir sur les symptômes d’urgenturie-pollakiurie, traiter les épisodes d’incontinence, soulager les symptômes de rétention non consécutifs à une obstruction mais aussi agir sur l’incontinence mixte (urinaire et fécale) ainsi que sur la constipation.
Il s’agit de stimuler, au moyen d’un neurostimulateur implantable relié à des électrodes, les nerfs S3 innervant les organes du petit bassin et situés au niveau du sacrum. Après une première phase de test pour vérifier que le patient répond à la stimulation, le boîtier de neuromodulation (qui fait à peu près la taille d’un pacemaker) est implanté en sous-cutané au-dessus de la fosse iliaque. Le fil reliant l’électrode au boîtier est tunnelisé sous la peau.
Malgré quelques tentatives de traitement des troubles mictionnels•G par stimulations électriques dans les années soixante, la thérapie naquit véritablement en 1981. Un groupe d’étude de l’université de Californie démarra un programme clinique à partir d’études sur le chien afin d’évaluer les résultats d’une stimulation permanente relative à certains troubles mictionnels. Il fallut pourtant attendre 1997 pour que la Food and Drug Administration, l’agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, reconnaisse la neuromodulation comme un traitement des troubles mictionnels réfractaires aux traitements conventionnels (hyperactivité vésicale et rétention sans obstruction).
Un traitement à part entière
La thérapie bénéficie à présent d’un recul de vingt ans. Son utilisation dans le traitement de l’hyperactivité vésicale à la fois pour les patients souffrant d’incontinence d’urgence, d’urgenturie pollakiurie et de rétention urinaire a été prouvée. A cinq ans, 68 % des patients avec une incontinence urinaire par urgenturie sont toujours répondeurs à la thérapie. Cette technique a considérablement évolué au cours de ces vingt dernières années et un nouveau stimulateur est utilisé depuis 2008. Cette version est miniaturisée et la connexion se fait directement à l’électrode alors que l’on devait, auparavant, la relier à une extension, elle-même connectée au stimulateur. Ces améliorations ont permis de réduire le temps d’intervention et donc de manipulation.
Des perspectives d’avenir élargies
Des protocoles sont en cours pour améliorer la prise en charge des patients et explorer de nouvelles indications comme les douleurs chroniques au niveau du petit bassin. Des recherches sont également menées pour améliorer les produits et réaliser le suivi à distance mais aussi améliorer la compatibilité en matière d’IRM pour les patients porteurs d’un système implantable, certains d’entre eux demeurant non compatibles.
L’avenir devrait privilégier quant à lui deux chantiers : d’une part, la recherche d’une amélioration clinique, avec la réalisation de nouvelles études sur l’efficacité et les complications suite à l’implantation, afin de mieux connaître les meilleurs candidats à ce traitement et d’optimiser les paramètres de stimulation. D’autre part, une action de communication pour briser le tabou qui entoure ces pathologies particulièrement invalidantes dont les malades ont encore du mal à parler. Car si elles concernent beaucoup de patients, leur prise en charge demeure réduite. Un important effort de sensibilisation des patients doit donc être mené pour faire connaître les solutions thérapeutiques.