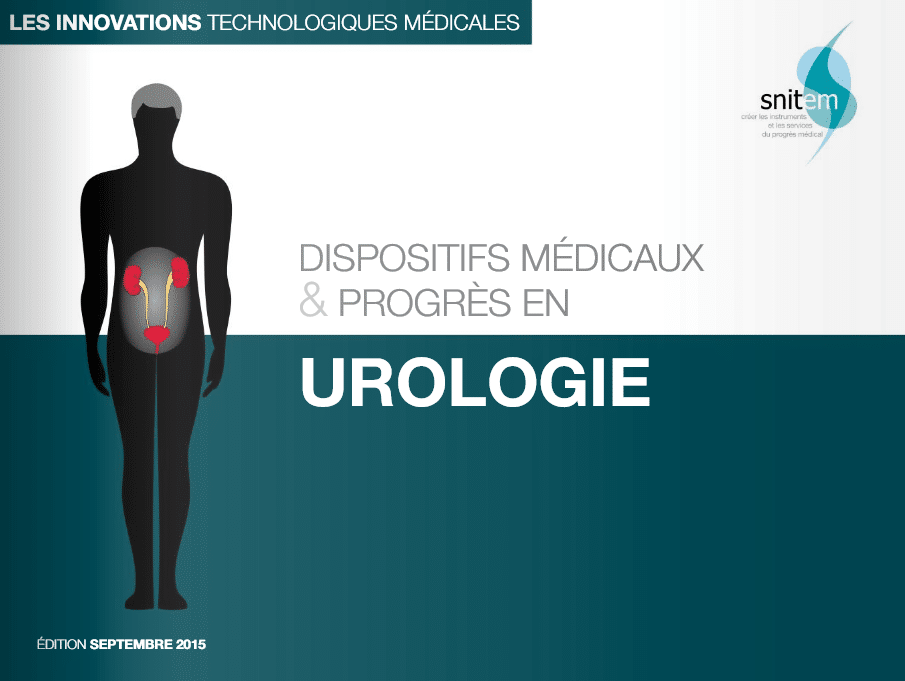Livret urologie
L'urologie est la première spécialité chirurgicale et médicale à s’être individualisée. Des dispositifs médicaux innovants ont radicalement changé la face de l’urologie et ouvert des perspectives thérapeutiques jusqu’alors inédites. Retrouvez tous ces DM dans ce livret préfacé par le professeur Guy Vallancien.
1. Préface du Pr Guy Vallancien
Le progrès triomphe toujours
Pr. Guy VALLANCIEN, Membre de l’Académie Nationale de Médecine
Voilà une plaquette qui résume parfaitement l’essor de l’urologie en un siècle et demi, première spécialité chirurgicale et médicale à s’être individualisée. Poussée par les innovations incessantes que les hommes de l’art, le plus souvent, ont créée d’eux-mêmes et avec le concours indispensable de l’industrie des
matériels, l’urologie est restée indépendante et unie, les urologues utilisant tous les outils mis à leur disposition pour combattre le mal, chirurgie, endoscopique, systèmes extracorporels, sondes, lasers, ultrasons et autres techniques de moins en moins invasives.
Ces progrès créent des ruptures souvent brutales, voire parfois violentes qui suscitent autant de réactions et réserves apeurées, mais le progrès triomphe toujours. Il en fut ainsi de la chirurgie percutanée du rein dans traitement de la lithiase, des bandelettes dans la cure de l’incontinence, de la cœlioscopie dans les chirurgies pelvienne et rénale et aujourd’hui de la robotique qui bouleverse notre métier. Certains essais surviennent trop tôt, quand l’ingénierie n’est pas encore au point, et l’innovation tombe dans l’oubli jusqu’à ce qu’elle réapparaisse, parfois des années plus tard, quand les progrès scientifiques et technologiques permettent de réaliser de façon fiable ces produits nouveaux si utiles aux malades.
L’irruption de l’économie numérique vient à son tour transformer nos pratiques comme sans doute jamais elles n’ont été auparavant bouleversées. En étroite collaboration avec les industriels qui mettent au point et développent ces nouveaux outils, nous devrons adapter et repenser notre rôle de médecin pour mieux servir les malades qui, chaque jour, se confient à nous.
2. Dans les moindres recoins de l’appareil urinaire
En quarante ans, une poignée de dispositifs médicaux innovants ont radicalement changé la face de l’urologie et ouvert des perspectives thérapeutiques jusqu’alors inédites.
L’urologie s’intéresse à toutes les pathologies de l’appareil urinaire chez la femme et chez l’homme. Si ces troubles préoccupent les médecins depuis l’Antiquité, l’urologie moderne a émergé dans le sillage du chirurgien français Felix Guyon à la fin du XIXe siècle, lorsque ce dernier fonda le premier service dédié à l’urologie à l’hôpital Necker à Paris. D’autres suivirent bientôt à Toulouse, Lyon, Marseille, Lille ou Montpellier, témoins de l’affirmation de la spécialité. Dès lors et tout au long du XXe siècle, la spécialité n’a cessé de se développer au rythme des progrès techniques et de l’évolution de la fréquence des pathologies traitées. Il est vrai qu’avant la Seconde Guerre mondiale, la tuberculose et ses complications rénales justifiant une néphrectomie•G constituaient une part importante des interventions effectuées par les urologues. Aujourd’hui, ce sont les cancers urologiques qui, à eux seuls, représentent 40 % de l’activité de ces mêmes spécialistes. Des maladies fonctionnelles, comme les incontinences, aux infections, comme les cystites ou les pyélonéphrites•G, en passant par les lithiases rénales et la traumatologie consécutive aux lésions du bassin, l’urologie est aux prises avec tout le spectre de la médecine. Aussi n’est-il pas surprenant qu’elle ait été un terrain fertile pour l’innovation portée par une double ambition : faciliter l’exploration des voies urinaires dans ses moindres recoins dans un but diagnostic et inventer ou affiner les traitements de manière à assurer le bon fonctionnement des organes.
L’urologie a profité, au même titre que d’autres spécialités médicales, de deux innovations majeures survenues ces quarante dernières années. D’abord, l’imagerie en général et l’échographie en particulier qui ont permis d’accéder à des zones de l’appareil urinaire jusqu’alors difficiles d’accès. Par ailleurs, l’endoscopie, qui consiste à utiliser les voies naturelles pour explorer le système urinaire, doit à la miniaturisation des instruments de chirurgie son formidable essor entamé dans les années quatre-vingt. De même, la cœlioscopie et, plus récemment, la coeliorobotique cumulent les atouts du numérique et de la robotique pour naviguer à vue dans l’appareil urinaire avec une précision extrême au travers de petites incisions. Cette chirurgie mini-invasive en était à ses balbutiements il y a encore trente ans.
Dans le champ plus restreint de l’urologie, les bandelettes sous-urétrales et les lithotriteurs apparaissent comme deux innovations de rupture, respectivement dans la prise en charge des incontinences urinaires d’effort et des lithiases rénales. L’invention des bandelettes est d’autant plus marquante que le concept est relativement simple puisqu’il s’agit d’une bande de tissu positionnée sous la partie moyenne de l’urètre•G pour le soutenir. Encore fallait-il y penser alors qu’au milieu des années quatre-vingt-dix, la majorité des urologues avaient les yeux rivés sur le col de la vessie qu’ils pensaient responsables des troubles. Quant au lithotriteur, il a pris le relais, au début des années quatre-vingt, des interventions à ciel ouvert pratiquées sur les patients souffrant de coliques néphrétiques et permis de leur proposer un traitement certes peu confortable au début mais autrement moins délabrant et qui s’est finalement imposé. Une révolution née dans les hangars d’un industriel de l’aéronautique, a priori très loin de la médecine...
La sonde double J, inventée par un urologue dans le but de traiter des sténoses urétérales, fait partie de ces innovations vite devenues indispensables, ce qui témoigne de sa pertinence. De fait, cette petite sonde aux extrémités recourbées constitue aujourd’hui la clé de voûte des traitements conservateurs du rein dès lors que celui-ci est bloqué, quelle qu’en soit la raison (calculs rénaux, tumeur du rein ou de l’uretère•G, compression de l’urètre).
D’autres inventions ont pour principal intérêt d’avoir énormément amélioré la qualité de vie des patients. C’est entre autres le cas du sphincter artificiel qui, même s’il concerne relativement peu de personnes, constitue un véritable défi technologique et une solution ultime pour traiter certaines incontinences urinaires chez l’homme.
L’urologie a beau avoir bénéficié d’innovations spectaculaires tout au long du XXe siècle, la source ne semble pas prête de se tarir à en juger par les progrès technologiques réalisés dans la spécialité depuis les années deux mille. Les lasers apparus il y a une quinzaine d’années pour traiter l’hypertrophie bénigne de la prostate et qui concurrencent désormais les chirurgies de référence, fussent-elles endoscopiques, permettent tantôt de s’affranchir de nouvelles limites telles que le volume de la prostate ou les comorbidités du patient. Le progrès se mesure aussi à la réduction des complications et des effets secondaires de l’intervention. À cet égard, les ultrasons focalisés de haute intensité permettent de traiter les cancers localisés de la prostate avec une précision telle que les tissus voisins sont très largement épargnés. Et ce, sans perte d’efficacité thérapeutique sur la tumeur.
3. Uroendoscopie
Voyage au centre de l’appareil urinaire
Encore balbutiantes au début des années quatre-vingt, les techniques d’endoscopie permettent aujourd’hui d’explorer le système urinaire dans ses moindres recoins et de traiter plusieurs de ses pathologies parmi les plus agressives. Un succès sur le tard qui doit beaucoup à une succession d’innovations venues de la physique, de l’optique et du traitement de l’image.
L’endoscopie est d’abord une méthode d’exploration visuelle de l’intérieur d’un organe ou d’une cavité. En urologie, elle permet d’explorer l’intégralité de l’appareil urinaire : urètre, vessie, uretère et reins. L’examen sert à étudier l’anatomie et la paroi interne des organes urinaires dans le but de détecter une tumeur, de révéler les lésions dues à une maladie infectieuse ou de rechercher une malformation congénitale. Plus récente, la chirurgie endoscopique consiste à pratiquer une intervention dans l’appareil urinaire en y accédant par les voies naturelles. La technique a fourni la preuve de son efficacité dans plusieurs indications telles que la résection de tumeurs (vessie, rein, prostate) ou d’un adénome prostatique, l’ablation d’un rein et de son uretère ou encore, l’extraction de calculs rénaux. Elle constitue ainsi, dans certaines indications, une alternative à la chirurgie percutanée du rein ou à la chirurgie ouverte. Endoscopie et endoscope sont des termes génériques remplacés par d’autres dès lors que la technique et l’instrument concernent un organe particulier. Ainsi parle-t-on de cystoscopie ou endoscopie vésicale et de cystoscope pour la vessie, d’urétroscopie pour l’urètre voire d’urétrocystoscopie quand il s’agit d’explorer à la fois la vessie et l’urètre. L’examen des uretères se nomme urétéroscopie.
L’examen endoscopique consiste à introduire l’instrument par l’urètre puis à le guider à travers l’appareil urinaire jusqu’à la zone ciblée. L’endoscope est une longue tige très mince, de quelques millimètres de diamètre, équipé d’une source lumineuse reliée à un système optique ou vidéo qui véhicule des images de haute résolution d’un bout à l’autre de l’appareil. La tige est étanche sur toute sa longueur afin de limiter les infections et d’éviter de dégrader l’instrument. Un canal opérateur adjacent sert à passer les instruments nécessaires en cas d’intervention chirurgicale. On distingue trois catégories d’endoscopes : rigides, semi-rigides et souples. Schématiquement, les endoscopes rigides sont préférentiellement utilisés pour explorer les voies basses. Plus il y a besoin de remonter dans l’appareil urinaire, plus les endoscopes doivent pouvoir épouser ses formes sinueuses afin de ne pas abîmer les organes ni léser leurs muqueuses. Ainsi a-t-on besoin d’instruments semi-rigides pour aller jusqu’aux uretères et d’endoscopes souples pour atteindre les reins et ses canaux étroits. Le geste s’effectue sous anesthésie locale ou générale. Pour une endoscopie vésicale, il est nécessaire de déplisser la vessie pour mieux observer sa muqueuse. Une fois le cystoscope positionné, l’organe est rempli d’eau stérile le temps de l’examen, c’est-à-dire pendant quelques minutes.
Avant la mise au point des premiers endoscopes au cours du XIXe siècle, voir à l’intérieur du corps relevait de l’utopie. Un premier pas fut franchi dès 1826 lorsque Pierre Salomon Ségalas d’Etcheparre conçut en 1826 un speculum urétrocystique. Grâce à deux bougies et à des miroirs habilement positionnés pour conduire la lumière vers la vessie, celle-ci devint visible à l’œil du médecin. Quelque trente années après, le Dr Desormeaux, urologue français, inventa le premier véritable endoscope (voir encadré). Par la suite, une panoplie complète d’instruments qu’il était possible d’introduire par voie naturelle fut développée dans le but d’explorer la vessie et de fragmenter les calculs qui s’y trouvaient emprisonnés. Dès le début du XXe siècle, un cystoscope préalablement introduit dans la vessie permit d’explorer la voie urinaire supérieure. L’examen s’avéra alors très utile pour diagnostiquer la tuberculose rénale, affection particulièrement répandue à l’époque.
D’autres développements techniques ont suivi au cours de ce siècle, notamment l’amélioration de la qualité des systèmes optiques et la miniaturisation des endoscopes. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, un industriel fabriquant des loupes binoculaires s’intéressa aux endoscopes et chercha à
en améliorer l’optique. Les possibilités techniques étaient alors très limitées : lors des examens, on éclairait l’intérieur du corps avec des ampoules électriques miniaturisées ou bien on tentait de refléter la lumière d’une source extérieure dans le corps, via le tube endoscopique. L’industriel essaya autre chose et inventa le principe de l’éclairage lumière froide : une puissante source de lumière produite en externe est transmise par le biais d’un câble à fibre optique fabriqué dans un matériau transparent comme du verre. La fibroscopie était née et introduisit de la souplesse. Efficace, la méthode s’imposa et jeta les bases de l’endoscopie moderne. Puis dès 1965, l’ajout d’un système de lentilles cylindriques mises au point par le physicien anglais Harold Hopkins améliora notablement l’optique de l’appareil. Les endoscopies concernent encore exclusivement le bas appareil urinaire mais déjà, la résection endoscopique de la prostate et celle des tumeurs vésicales sont pratiquées en routine. Les endoscopes utilisés sont métalliques et rigides.
De semi-rigide à souple
L’urologie bénéficie grandement de ces avancées technologiques mais elle n’est pas la seule, loin de là. D’autres spécialités chirurgicales comme la gastroentérologie, l’ORL et la pneumologie ont également recours à l’endoscopie et contribuent à en développer les techniques, les matériaux et les instruments. À la fin des années soixante-dix, l’endoscopie est mise à contribution pour tenter de soigner les lithiases rénales (voir chapitre 4), alors traitées exclusivement en chirurgie à ciel ouvert faute de pouvoir accéder autrement aux voies excrétrices des reins. En 1982, les Espagnols Martinez-Pineiro et Perez-Castro conçurent le premier urétéroscope qui permit de remonter dans les reins via la vessie. Il était semi-rigide et s’il permit d’accéder aux calculs localisés dans les uretères, il n’était pas adapté pour cheminer dans les canaux pyéliques du rein où peuvent aussi se loger des calculs. Les urétéroscopes souples apportèrent la solution et une première génération de ces appareils apparut en 1987. Plus longs que les endoscopes rigides, ils sont aussi plus fins de manière à pouvoir accéder à toutes les cavités du rein. Ce sont des instruments fragiles, qui demandent à être manipulés avec beaucoup de précautions. Ces endoscopes bénéficiant d’une lumière froide puissante, les résections aussi se développent. Et avec elles, les résecteurs de petit calibre pouvant être introduits plus facilement dans l’urètre.
En 1991, la crise de la vache folle battait son plein et la réalité du risque infectieux lié à l’usage des endoscopes, qui ne sont pas des dispositifs à usage unique, sauta aux yeux. Des contraintes réglementaires de stérilisation du matériel virent le jour et s’imposèrent aux fabricants d’instruments. L’effet fut immédiat : la composition des endoscopes fut revue de manière à ce que ses différents matériaux résistent aux traitements qu’ils devaient désormais subir.
Aller au-delà des possibilités de l’oeil humain
À mesure que les indications de l’endoscopie urologique s’étendirent, les endoscopes se perfectionnèrent. Les matériaux qui les composaient gagnèrent en flexibilité et en résistance. Parallèlement, une série d’instruments spécifiques se développa, qui furent d’abord inspirés par ceux employés en chirurgie ouverte. Ce fut notamment le cas des pinces à préhension, à biopsie et des ciseaux qu’il fallut adapter aux exigences de l’endoscopie, c’est-à-dire en premier lieu miniaturiser pour qu’ils puissent être amenés et manipulés sur le site d’intervention. De nouveaux instruments virent le jour à l’instar des bistouris électriques à courants haute fréquence ou au laser qui permirent aux chirurgiens-urologues de pratiquer sous endoscopie des interventions de plus en plus complexes avec toute la précision requise. L’arrivée très récente dans les services d’urologie des premiers endoscopes consommables, à usage unique, laisse entrevoir la perspective d’un usage facilité dans les services car affranchi de certaines contraintes de nettoyage et de stérilisation.
Dans les années 2000, la vidéoendoscopie jusqu’à alors employée seulement en gastroentérologie, s’étendit à l’urologie. La miniaturisation des caméras vidéo embarquées afin de retransmettre les images sur un écran rendit possible l’usage de cette technique de pointe dans la vessie et dans l’urètre. Par ailleurs, la numérisation des systèmes optiques facilite le traitement des données car elle fournit des images de meilleure résolution sur lesquelles s’appuient les médecins pour affiner leurs diagnostics et mieux circonscrire la zone de leurs interventions. Le défi de la haute définition étant en passe d’être relevé, c’est une nouvelle transition technologique qui se profile. L’enjeu consiste à aller au-delà des possibilités de l’œil humain pour révéler à l’image le réseau vasculaire, notamment celui qui irrigue la vessie. Objectif : dépister précocement d’éventuelles tumeurs et les retirer par courant haute fréquence avant qu’elles ne s’infiltrent dans la muqueuse vésicale et atteignent la partie musculaire de l’organe. Pour effectuer une telle exploration, appelée Photodiagnostic dynamique (PDD) ou endoscopie de fluorescence, il faut disposer d’une caméra spéciale à lumière bleue qui révèle les tumeurs en rose. L’urétéroscopie souple à haute résolution commence elle aussi à bénéficier de cette technologie qui améliore le diagnostic et le traitement des tumeurs du haut appareil urinaire. La technologie NBI (de l’anglais Narrow Band Imaging) consiste, quant à elle, à appliquer des filtres à la lumière blanche afin de faire ressortir sur les images les vaisseaux sanguins et les tissus tumoraux.
Eclairage
Antonin Jean Desormeaux , le père de l’endoscopie
Au milieu du XIXe siècle, l’urologue français Antonin Jean Desormeaux mit au point un appareil pour voir à l’intérieur de la vessie, qu’il baptisa endoscope. Séduit par les possibilités d’examen direct offertes par le laryngoscope et l’ophtalmoscope, deux découvertes de l’époque, le médecin ébaucha les plans d’un instrument permettant d’explorer l’urètre avant de prendre contact avec un industriel. Ensemble, ils cherchèrent une source lumineuse assez puissante, peu encombrante et produisant une lumière blanche. L’ampoule électrique n’existait pas encore... Finalement leur choix se fixa sur une lampe à gazogène qui brûlait un mélange d’essence et de térébenthine. Le premier urétroscope de Desormeaux était muni d’une gaine droite et fermée. Bientôt, une autre gaine compléta l’instrument. Elle était ouverte et munie d’une fente, ce qui permit d’y introduire de fins instruments. L’appareil pesait plus d’un kilo. Sa source de lumière était dangereuse pour les cuisses du patient comme pour les favoris, les sourcils et la moustache de l’opérateur. Sa puissance était faible, si bien qu’il était impossible d’examiner totalement la vessie ou de voir les orifices urétéraux. Toutefois, après quelques mois d’utilisation, l’urologue adressa à l’Académie de Médecine un descriptif de son instrument et vint le présenter officiellement le 20 novembre 1853.
Eclairage
« L’endoscopie a encore de beaux jours devant elle »
Pr Olivier Traxer, urologue à l’hôpital Tenon (Paris).
« L’uroendoscopie a réellement pris son envol dans les années quatre-vingt. Elle est
à son apogée aujourd’hui car les instruments permettent d’aller partout dans l’appareil urinaire, y compris dans les zones les moins faciles d’accès. Pour autant, nous n’avons pas encore atteint les limites de la méthode aussi bien pour l’exploration que pour l’intervention chirurgicale. Tous les six mois, on voit arriver de nouveaux instruments toujours plus performants. Au niveau du rein, la précision optique est d’ores et déjà incroyable. Des outils embarqués comme
le laser, disponibles depuis quelques années seulement, permettent désormais de traiter les tumeurs urothéliales des uretères et tous les types de calculs par endoscopie, ce qui était inimaginable il y a quinze ans. Les instruments sont aussi moins traumatiques qu’hier car plus petits et plus souples.
Il reste des choses à inventer. La recherche actuelle vise notamment à développer l’uroendoscopie en vision 3D ou des outils plus performants pour casser les calculs ou retirer des polypes. »
4. Cœlioscopie
Vers la chirurgie mini-invasive et robotique
Le développement de la chirurgie mini-invasive, cœlioscopie en tête, contribue à l’essor d’une chirurgie urologique moins agressive, moins douloureuse et plus précise. Au grand bénéfice des patients... comme des chirurgiens.
La chirurgie mini-invasive désigne un ensemble de techniques chirurgicales diagnostiques et d’intervention qui visent à minimiser le traumatisme opératoire par rapport à la chirurgie conventionnelle, au premier rang desquelles la douleur post-opératoire et les séquelles sur les organes voisins et tissus adjacents. Elle inclut la cœlioscopie simple ou par robot-assistance et les traitements focalisés non invasifs au moyen d’ultrasons. Les progrès technologiques de ces dernières années portant sur les instruments, l’imagerie, le traitement de l’image et les systèmes de navigation ont rendu possible la pratique d’une chirurgie mini-invasive du rein, de la prostate et de la vessie.
En cœlioscopie, le système optique et les instruments sont manipulés à distance par le chirurgien qui visualise tout le champ opératoire sur écran, donc en deux dimensions. Ils sont introduits au niveau des organes cibles au travers de tubes appelés trocarts, eux-mêmes positionnés dans de petits orifices de quelques millimètres percés dans la paroi abdominale du patient. Le nombre et la localisation des orifices de trocarts dépendent du type d’intervention et des conditions opératoires. L’abdomen du patient est préalablement gonflé avec du dioxyde de carbone gazeux de manière à créer un espace de travail où placer les trocarts. La cœlioscopie robot assistée repose sur le même principe, si ce n’est que le robot est au chevet du patient. Ses bras sont arrimés aux trocarts. Ainsi le robot peut introduire et manipuler directement les instruments selon les consignes du chirurgien installé dans une autre pièce. Ce dernier manipule le robot à l’aide d’une console et dispose d’une vision en trois dimensions et à 360 degrés du champ opératoire. Quant aux traitements focalisés, ils exploitent les caractéristiques physiques des ondes ultrasonores pour détruire certains tissus tout en épargnant le reste de l’organe.
De la cœlioscopie...
« La cœlioscopie était balbutiante il y a quarante ans. Aujourd’hui, elle est devenue une technique de routine en urologie », résume le Pr Emmanuel Chartier-Kastler, Président de la collégiale d’urologie à l’AP-HP. En France, la cœlioscopie est née dans le giron de la gynécologie, d’abord pour désobstruer les trompes utérines de femmes ayant subi des avortements clandestins. Il y avait déjà eu quelques tentatives d’introduire un appareil d’optique dans la cavité abdominale dès le début du XXe siècle mais un tel mode d’exploration ne connut alors aucun succès. Le médecin français Raoul Palmer, spécialiste des questions de fertilité, y eut recours dès 1943 puis perfectionna la technique et les instruments pour ponctionner des kystes de l’ovaire, faire des prélèvements ou préciser des diagnostics pré-opératoires en gynécologie. À cette époque, la communauté chirurgicale n’était pas convaincue de l’intérêt de cette technique imparfaite alors qu’il est si facile d’ouvrir un ventre... L’arrivée des fibres optiques dans les années soixante-dix améliora sensiblement la qualité de l’éclairage et la maniabilité des instruments. Mais ces derniers étaient encore introduits dans l’abdomen par le même orifice que l’optique, ce qui limite les possibilités techniques d’intervention. L’idée germe alors d’utiliser des orifices supplémentaires. Petit à petit, des chirurgiens d’autres spécialités s’intéressent à cette approche, d’abord en gastro-entérologie puis en urologie à la fin des années quatre-vingt. En 1987, le Dr Philippe Mouret réalisa à Lyon une cholécystectomie•G sous cœlioscopie, intervention jusque-là inédite.
Dans les premières années, la cœlioscopie se développa doucement en urologie. Les premiers résultats de prostatectomie radicale par cœlioscopique, en 1991, furent décevants. Les choses auraient pu en rester là si le Pr Guy Vallancien, urologue français, et son équipe de l’Institut Mutualiste Montsouris n’avaient pas persévéré et poursuivi le développement de la technique. Les premières néphrectomies furent effectuées au cours des années quatre-vingt-dix, aux États-Unis puis en France, suivies par les premiers curages ganglionnaires pour traiter des cancers. Au tournant du XXe siècle eurent lieu les premières prostatectomies totales. Les instruments chirurgicaux s’adaptèrent à cette nouvelle pratique. Les trocarts métalliques ou plastiques, permettant le passage des instruments au travers la paroi, mesuraient tout au plus 10 à 12 millimètres. Par ailleurs, ils limitaient l’angle d’attaque des tissus. Les ciseaux cœlioscopiques, différents modèles de pinces, positionneurs d’aiguilles, dissecteurs, scalpels et autres canules d’aspiration tinrent compte de ces contraintes. Des instruments flexibles et articulés, dont la manipulation exige de l’entraînement, virent le jour dans le but de faciliter le travail des chirurgiens. En cœliochirurgie, l’énergie électrique fut mise à contribution pour obtenir de la chaleur et produire ainsi différents effets sur les tissus. Deux techniques, l’une monopolaire et l’autre bipolaire, furent mises au point dans cette optique. L’énergie monopolaire est obtenue au moyen de deux électrodes distantes, l’une active et l’autre neutre. En chirurgie bipolaire, les deux électrodes sont identiques et intégrées au même instrument. Les pinces de thermofusion, dont les premiers modèles apparurent dans les années quatre-vingt-dix, utilisent ce courant bipolaire pour provoquer la fusion des vaisseaux, ce qui permet de stopper préventivement un saignement et/ou de couper des tissus. « Des instruments créés pour la cœlioscopie ont fait faire d’immenses progrès à la chirurgie ouverte », estime le Pr Pascal Rischmann, chef du service d’urologie au CHU Rangueil (Toulouse). La caméra joua également un rôle déterminant dans l’approche cœlioscopique. À ce titre, elle est devenue un véritable instrument chirurgical. Alors que les premières caméras cœlioscopiques étaient de faible sensibilité et de résolution modeste, elles bénéficient aujourd’hui de technologies numériques avancées et sont beaucoup plus performantes.
... à l’urochirurgie assistée
La chirurgie mini-invasive franchit un pas supplémentaire lorsque débarquèrent, dès 2008 en France, des assistants-robots qui conférèrent aux gestes chirurgicaux une extrême précision. Pour le chirurgien, qui pilote le robot à distance, le gain en confort est important car il opère assis, dans une position stable. Il bénéficie par ailleurs d’une vision 3D binoculaire, ce que la cœlioscopie conventionnelle ne permet pas. Compte tenu du coût élevé de ces équipements hautement technologiques et de la nécessité d’un bon apprentissage à leur usage, le recours à la chirurgie robot-assistée n’est pas systématique. Elle concerne prioritairement les interventions pour lesquelles une adresse très élevée est requise de manière à préserver au mieux les tissus et la fonction des organes voisins. C’est le cas de la prostatectomie radicale, au cours de laquelle il s’agit de préserver les structures neuromusculaires intervenant dans les fonctions de continence et d’érection. Pour des chirurgies complexes du haut appareil urinaire ou de malformation rénale, le robot apporte également une plus-value. Plus largement, de nouvelles perspectives s’ouvrent pour l’urologie avec le développement de la chirurgie assistée par ordinateur. Les techniques de reconstruction 3D et de fusion d’images obtenues par échographie ou par IRM fournissent une aide précieuse aux chirurgiens. Elles facilitent, par exemple, le guidage lors des interventions chirurgicales percutanées sur les calculs. « L’innovation en urologie semble fortement liée aux progrès de l’imagerie et aux interactions fortes développées avec la radiologie », pointe le Pr Chartier-Kastler.
Eclairage
« Nous avons redécouvert l’anatomie »
Pr Pascal Rischmann, chef du service d’urologie au CHU Rangueil à Toulouse
« Au début des années 2000, seulement un tiers des urologues passaient le pas d’opérer en cœlioscopie. Il est vrai que c’était techniquement plus difficile qu’une chirurgie à ciel ouvert et qu’il était nécessaire, pour être fiable, de s’entraîner en répétant souvent les gestes. Depuis, la cœlioscopie s’est imposée comme la technique de référence pour la grande majorité des interventions de routine en urologie. La chirurgie à ciel ouvert reste la référence pour les grosses chirurgies, complexes ou qui saignent beaucoup. La cœlioscopie est arrivée à maturité, les urologues la maîtrisent bien. De gros progrès ont été accomplis au niveau des sources lumineuses et de l’optique des instruments. La qualité des écrans a elle aussi considérablement augmenté. C’est bien simple : nous voyons mieux aujourd’hui en cœlioscopie qu’à ciel ouvert. Grâce à la cœlioscopie, nous avons redécouvert l’anatomie... »
Eclairage
Une idée venue du Vietnam
Comment soigner les blessés sur le front sans exposer les médecins en première ligne ?
À l’issue de la guerre du Vietnam, l’Amérique compta ses morts. Estimant que plusieurs d’entre eux auraient pu être sauvés s’ils avaient pu être soignés plus rapidement, le Pentagone souhaita mettre au point un robot capable d’opérer à distance les blessés sur les champs de bataille. À l’université Stanford, des médecins militaires se penchèrent sur cet ambitieux projet. Leurs travaux firent avancer les technologies permettant de voir un homme et de manipuler des instruments tout en restant éloigné de lui. En 1995, une société racheta ces licences technologiques pour commercialiser des applications civiles. Ce fut chose faite quatre ans plus tard, en 1999, avec la mise sur le marché américain du premier système robotisé de cœlioscopie qui marqua une étape décisive dans la chirurgie mini-invasive.
5. Troubles fonctionnels urinaires
L’apport des dispositifs médicaux implantables et temporaires
Bandelettes, stents urétraux, sondes, poches de recueil urinaire... En quelques décennies, ces dispositifs médicaux ont révolutionné, chacun à leur manière, l’approche thérapeutique des troubles fonctionnels du bas appareil urinaire, contribuant ainsi à améliorer la qualité de vie des patients touchés par ces pathologies très gênantes voire invalidantes et souvent taboues. Par ailleurs, leur mise au point a accompagné l’essor de la chirurgie urologique. Explications.
La vessie est le réservoir dans lequel l’urine provenant des reins est stockée avant d’être évacuée lors de la miction en passant par un canal de sortie, l'urètre. Elle peut contenir jusqu'à 300 ml. Normalement le premier désir d'uriner parfaitement fugace apparaît quand le volume d’urine stockée dans la vessie atteint 150 à 250 ml. L’intervalle normal entre deux mictions est supérieur à deux heures, sans miction la nuit ou avec au maximum une seule miction nocturne, ce qui aboutit à cinq à sept mictions par période de vingt-quatre heures.
Les troubles du bas appareil urinaire surviennent lorsque la vessie ne parvient plus à fonctionner normalement. Le remplissage vésical, la miction ou la phase post-mictionnelle peuvent être affectés. Ainsi les incontinences urinaires, définies comme des fuites involontaires d'urine, traduisent soit un problème de stockage, soit un trouble de vidange caractérisé par un jet d'urine affaibli ou haché.
La prévalence de ces troubles est difficile à apprécier en raison du tabou social qui, encore aujourd'hui, entoure ces troubles et d'un sous-diagnostic évident de beaucoup d'entre eux, aussi bien chez les hommes que les femmes. La vie des personnes n'est généralement pas en jeu, à la différence d'autres pathologies uronéphrologiques comme les cancers ou l'insuffisance rénale. Pour autant, les troubles du bas appareil urinaire ont un impact social important et peuvent causer aux personnes qui en souffrent de réelles difficultés dans la vie quotidienne et leurs activités. Par ailleurs, les dysfonctionnements à l'origine de ces troubles peuvent faire le lit de pathologies infectieuses potentiellement graves et/ou provoquer des dommages irréversibles, notamment au niveau des reins. Les solutions pour restaurer une fonction mictionnelle normale combinent rééducation, mesures hygiéno-diététiques et chirurgie. Les dispositifs médicaux implantables ou temporaires issus de collaborations au long cours entre chirurgiens urologues et industriels, tels que les bandelettes, les prothèses sphinctériennes, les sondes JJ (également appelées double J) ou les sondes à drainage vésical urinaire, sont devenus incontournables en raison de leur succès thérapeutique. D'autres, tels que les stents urétraux, ont su trouver leur place en apportant une réponse inédite dans certaines indications, complétant ainsi la palette des options thérapeutiques.
Eclairage
« L’urologie ne peut plus se passer des dispositifs médicaux implantables »
Pr Emmanuel Chartier-Kastler, urologue à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Paris).
« Les premiers sphincters urinaires ont été posés il y a quarante ans. Aujourd’hui, nous en implantons près de 1500 chaque année. La neuromodulation sacrée fait quant à elle l’objet de 500 implantations par an, ce qui est loin d’être négligeable. La pose de sondes double J dans l’urètre est devenue un acte de routine. Et je ne parle pas des bandelettes, technique simple et efficace pour remédier aux incontinences d’effort et qui ont transformé la vie de milliers de femmes. Dans le champ de l’andrologie, les implants péniens ont beaucoup amélioré le traitement des dysfonctions érectiles. Certes, cela concerne relativement peu d’hommes mais le progrès technologique est réel. Ces progrès doivent beaucoup au développement de nouveaux matériaux. La simple sonde urinaire en latex ou en PVC par exemple a été remplacée par du silicone et on voit apparaître des sondes renforcées pour résister aux compressions, ce qui allonge leur durée de vie. Là encore, il s’agit d’innovations importantes qui améliorent et facilitent la prise en charge des patients. Elles font désormais partie intégrante de l’urologie qui aurait bien du mal à s’en passer. »
6. Bandelettes sous-urétrales
Le traitement tant attendu
Les bandelettes sous-urétrales (BSU), dites aussi de soutènement, servent à traiter l’incontinence urinaire d’effort invalidante. Celle-ci concerne principalement la femme dont les muscles du périnée et du sphincter urinaire sont affaiblis. Ceci entraîne des fuites involontaires d’urine qui sont fréquentes dans la population féminine car l’urètre de la femme est très court, son sphincter peu puissant et son périnée soumis à rude épreuve lors de la grossesse et de l’accouchement. Après la ménopause, une fragilité supplémentaire s’installe en raison de l’assèchement des tissus dû au manque d’hormones. Le recours aux bandelettes est indiqué lorsque la rééducation périnéale a échoué ou que l’incontinence à l’effort est très importante.
L’homme peut lui aussi souffrir d’incontinence urinaire d’effort, notamment à la suite d’une chirurgie de la prostate. Le sphincter externe n’est plus suffisamment efficace pour retenir l’urine en cas d’efforts tels que la toux, le rire ou certaines activités sportives.
Une bandelette sous-urétrale est une bande de tissu synthétique d’1 à 2 cm de large, que le chirurgien positionne sous le col vésical afin de le soutenir, tel un hamac, lors des efforts.
Ses extrémités sont attachées aux parois abdominales. On distingue deux techniques selon la voie
d’abord choisie par le chirurgien : transobturatrice (Transobturator tape, TOT) ou rétropubienne (Tension-free vaginal tape, TVT).
Parce qu’elles ne mettent pas en jeu la vie du patient, les incontinences urinaires d’effort n’ont jamais fait partie des priorités médicales. Jusque dans les années quatre-vingt-dix, les tentatives chirurgicales pour en venir à bout ont donné naissance à une multitude de techniques différentes. Toutes visaient le même objectif : resserrer le col de la vessie situé dans la partie haute de l’urètre. L’hypothèse selon laquelle l’incontinence repose sur une faiblesse du col de la vessie était alors prédominante et guidait les chirurgiens dans leurs recherches. Ces interventions s’avéraient relativement délabrantes, sans compter qu’elles avaient tendance à générer de nouveaux troubles liés cette fois à l’évacuation des urines. Fort de ce constat, le Pr Ulf Ulmsten, gynécologue suédois, eut l’idée d’agir non plus sur la partie haute mais sur le tiers moyen de l’urètre en plaçant via le vagin une bandelette de tissu sous l’urètre. Son concept et son prototype présentés en 1995 furent d’abord accueillis avec circonspection par la communauté chirurgicale, dubitative quant à son efficacité. Un simple morceau de tissu relié à deux aiguilles, placé en quinze minutes par le chirurgien, parviendrait-il vraiment à traiter une fois pour toutes l’incontinence urinaire d’effort ? Inspirées du prototype du Pr Ulmsten, les premières bandelettes sous-urétrales furent commercialisées en 1997 sous le nom de TVT. La simplicité du geste chirurgical ainsi que les résultats très satisfaisants rapportés par les patientes eurent raison des dernières réticences parmi les urologues. Dès lors, la technique des bandelettes sous-urétrales posées par voie rétropubienne se répandit rapidement dans le monde entier et s’imposa comme la solution de référence contre les incontinences urinaires d’effort. Plus besoin d’opérer à ciel ouvert et de séjourner à l’hôpital pendant plusieurs jours : la pose d’une bandelette est un acte mini-invasif de chirurgie locale et celle qui en bénéficie peut rentrer chez elle dès le lendemain de l’intervention. Des travaux sont menés pour améliorer la biocompatibilité des tissus pour répondre aux attentes des chirurgiens en termes de résistance et d’élasticité. La technique chirurgicale évolua également. La voie ascendante empruntée par le Pr Ulmsten est susceptible de perforer la vessie. Une telle lésion, bien que réversible et sans conséquence pour le patient, complique le travail du chirurgien, qui cherche à s’en abstraire. Le Dr Delorme, urologue français, entreprit alors de poser la bandelette en passant ses aiguilles dans un orifice obturateur du bassin. Il inaugura ainsi la voie dite transobturatrice ou TOT. Son efficacité est comparable à celle des bandelettes TVT. Les industriels ont fait en sorte d’adapter le matériel à l’une et l’autre de ces techniques, à commencer par les aiguilles : droites et courbes pour une intervention ascendante, en tire-bouchon par voie transobturatrice.
Eclairage
L’alternative du sphincter artificiel
L’homme peut lui aussi souffrir d’incontinence urinaire d’effort, notamment à la suite d’une chirurgie de la prostate. Le sphincter externe n’est plus suffisamment efficace pour retenir l’urine en cas d’efforts tels que la toux, le rire ou certaines activités sportives. Le sphincter artificiel, posé autour de l’urètre de manière à le comprimer, peut alors prendre le relais. Le dispositif est composé de trois parties. Une manchette gonflable reliée à un ballon est placée autour de l’urètre. Au repos, la manchette est remplie de liquide et comprime ainsi l’urètre. Une pompe commande son ouverture. Lorsque le patient désire vider sa vessie, il actionne la pompe grâce à une poire, ce qui a pour effet de vider la manchette dont le liquide est chassé ver le ballon. La compression sur l’urètre étant levée, l’urine s’écoule. Après quelques minutes, le liquide revient dans la manchette et le blocage est rétabli. De même que les bandelettes peuvent être proposées aux hommes dans certaines circonstances, le sphincter artificiel peut être une solution contre l’incontinence féminine si les traitements classiques ont échoué ou ne sont pas indiqués.
Eclairage
Un stimulateur dans le bas du dos
Les troubles du plancher pelvien se manifestent par une hyperactivité vésicale, une incontinence urinaire d’effort voire des pertes involontaires de selles. En traitement de deuxième intention, lorsque les traitements conventionnels médicamenteux et de rééducation de cette zone du bassin échouent, les patients sélectionnés peuvent se voir proposer la neuromodulation des racines sacrées. La thérapie consiste à stimuler, par des impulsions électriques de faible intensité, les nerfs du sacrum situés juste au-dessus du coccyx et qui contrôlent les systèmes urinaire, digestif et fécal ainsi que l’activité du plancher pelvien. Le neurostimulateur est implanté sous la peau et la personne déclenche elle-même les impulsions à l’aide d’une télécommande. La technique mise au point aux États-Unis a d’abord bénéficié à des patients américains dans les années quatre-vingt. En France, la première implantation du genre a eu lieu en 1995. Les innovations technologiques ont déjà permis de réduire la taille des stimulateurs et de perfectionner son contrôle à distance. Elles se poursuivent, notamment pour améliorer la compatibilité de ces appareils avec l’Imagerie par résonance magnétique (IRM).
7. Stents urétraux
Libérez le passage !
Un stent urétral a pour but de dilater le canal urétral afin de rétablir une bonne évacuation des urines. Il s’agit alors de traiter la sténose de l’urètre, aussi appelée rétrécissement de l’urètre. Cette pathologie masculine se manifeste par une diminution de la pression du jet d’urine voire d’une miction douloureuse. Elle peut se produire n’importe où le long de l’urètre, de la vessie jusqu’à son orifice. Non traitée, elle risque de conduire à une dégradation de la fonction de la vessie puis des reins. La cause est souvent difficile à établir. Elle peut être infectieuse ou traumatique à la suite d’une chute à califourchon sur la barre d’un vélo ou d’un accident de la route avec fracture du bassin et déchirement de l’urètre. Lors de la cicatrisation, la paroi du canal urétral s’épaissit jusqu’à faire obstacle au passage de l’urine. La pose d’un stent est indiquée notamment pour les sténoses courtes survenant dans la portion bulbaire de l’urètre (à la racine du pénis), généralement en seconde intention après échec d’une urétrotomie interne.
Le stent urétral, ou endoprothèse urétrale, est un dispositif tubulaire métallique, maillé ou spiralé, qui ressemble à un petit ressort. Il est positionné à l’intérieur de l’urètre juste en face de la zone rétrécie de manière à maintenir ouvert le canal urinaire. Il est posé à l’aide d’un guide d’insertion constitué d’une gaine et d’un poussoir permettant d’installer le stent à l’endroit souhaité.
Le traitement chirurgical des sténoses urétrales repose sur un principe mécanique : contrer le rétrécissement d’une partie de l’urètre de manière à ce que l’urine puisse à nouveau être évacuée normalement. Le drainage des urines est pratiqué depuis l’Antiquité : en Égypte, on utilisait un tube de papyrus, en Chine, un tube en roseau. Au Ier siècle avant J.C., les sténoses urétrales étaient décrites comme des excroissances charnues ou calleuses de la muqueuse urétrale, nommées carnosités. Au XVIe siècle, pour dilater le canal rétréci mais aussi parfois pour détruire directement les carnosités, on recourut à des bougies et à des sondes en métal. Elles étaient de forme courbe afin de bien s’adapter au profil de l’urètre. Bien que la destruction chirurgicale des carnosités fût tentée avant le XVIIIe siècle, il fallut attendre cette époque pour que l’urétrotomie interne rétrograde démarre véritablement avec la mise au point d’un instrument dont le bout était équipé d’une lame émoussée à l’avant et tranchante à l’arrière. Les chirurgiens se mirent alors en chasse de matières plus souples, mieux tolérées et moins traumatisantes. C’est ainsi qu’un orfèvre-mécanicien français, utilisant du caoutchouc nouvellement importé en France, réalisa les premières sondes en gomme élastique lisse et de bonne consistance. Au milieu du XVIIIe siècle toujours, les chirurgiens qui pratiquent des dilatations fabriquent eux-mêmes leurs bougies avec du linge traité par un emplâtre de diachylon, de cire et d’huile d’olive. L’instrumentation se développa au XIXe siècle grâce aux progrès pour maîtriser le caoutchouc et l’acier ainsi qu’à la découverte de l’énergie électrique. Différents types d’urétrotomes furent mis au point pour remonter jusqu’au site de la sténose depuis la vessie puis sectionner la partie rétrécie de l’urètre. La plupart de ces instruments ont aujourd’hui disparu, non sans avoir largement contribué au développement de l’urétrotomie interne qui demeure le traitement de première intention.
Ce n’est qu’au cours des années quatre-vingt que les stents firent leur apparition. Autrement dit, très récemment dans l’histoire de la prise en charge des sténoses urétrales. Les premiers résultats relatifs à l’utilisation d’une endoprothèse pour le traitement des sténoses urétrales bulbaires récidivantes furent publiés en 1988. Les stents d’alors, issus de la chirurgie cardiovasculaire, étaient en acier, ce qui n’était pas sans poser des problèmes de biocompatibilité. Ils furent progressivement remplacés par des endoprothèses en alliages tels que le nitinol ou le phynox, à la fois biocompatibles et résistants à la corrosion. Le nitinol est un alliage à mémoire de forme utilisé pour fabriquer des endoprothèses dites thermoexpansibles car leur forme n’est pas la même à basse ou à haute température. Cette propriété est mise à contribution lors de la pose ou du retrait du stent. Malgré d’importants progrès visant à diminuer le taux de resténose dû à une cicatrisation hypertrophique, ce dernier reste relativement important après la pose d’un stent urétral. Aussi les industriels poursuivent-ils leurs recherches dans le but d’améliorer encore la composition des endoprothèses et d’affiner leur place dans la stratégie thérapeutique des sténoses urétrales, laquelle compte plusieurs autres approches chirurgicales.
Eclairage
La voie des lasers
Les premières utilisations du laser dans le cadre des sténoses urétrales datent des années quatre-vingt. Elles avaient vocation à diminuer le taux alors élevé de récidive après urétrotomie interne. Les résultats furent alors décevants et la technique resta au point mort. La mise au point de nouveaux lasers KTP et à l’holmium redonna de l’élan à cette approche au début des années deux mille. L’effet recherché est la vaporisation, qui permet de se débarrasser de l’ensemble des tissus fibrotiques et cicatriciels qui constituent la sténose tout en évitant de générer une réaction cicatricielle dans la zone traitée. L’intervention se fait par voie endoscopique. Dans de rares cas, elle est associée à la pose d’un stent.
8. Sondes à drainage vésical urinaire
Évacuer les urines
Le drainage, ou sondage urinaire, a pour but de permettre à l'urine stockée dans la vessie de s'écouler vers l'extérieur. Ce procédé de dérivation des urines, appelé sondage vésical, peut être nécessaire lorsque la vessie ne parvient plus à se vider naturellement et facilement car il existe alors des risques importants d’infection urinaire, d’altération rénale voire d’insuffisance rénale. On distingue les sondes urinaires intermittentes et celles à demeure. Les premières servent à évacuer les urines plusieurs fois par vingt-quatre heures. Elles sont proposées aux personnes souffrant de rétention urinaire aiguë ou chronique, associée ou non à des fuites urinaires incontrôlables, qui doivent apprendre à pratiquer elles-mêmes le geste du sondage. Les sondes urinaires à demeure restent en place entre quelques heures (sondage à demeure de courte durée) et plusieurs mois (sondage à demeure de longue durée). Elles s'adressent aux personnes incapables de pratiquer un sondage intermittent en raison d'une intervention chirurgicale récente, d'une déficience mentale ou physique, passagère ou pas.
La sonde urinaire est un tube mince, stérilisé et souple de 8 à 40 cm de long, qui est introduit dans la vessie par le canal de l’urètre. Elle est composée de matériaux synthétiques ou semi-synthétiques et d'un système de lubrification. Une poche de recueil est connectée au cathéter afin de recueillir l’urine. Pour le sondage vésical intermittent, on utilise des sondes urinaires à une voie. Pour le sondage vésical à demeure, les sondes urinaires à ballonnets, dites sondes de Foley, sont plus appropriées. Elles comportent à deux voies : l'une pour gonfler le ballonnet dans la vessie, ce qui sert à maintenir la sonde en place, l'autre pour collecter les urines. Il existe également des sondes urinaires à trois voies, qui permettent d’effectuer une irrigation vésicale continue.
Sondage intermittent
Au XVIIIe siècle, Benjamin Franklin confectionna des sondes urinaires pour drainer chaque jour les urines de son frère aîné qui souffrait de calculs rénaux. Pour rendre le geste moins douloureux, il mit au point, avec la complicité d'un orfèvre, un cathéter plus souple et percé pour permettre l'évacuation des urines. Les cathéters coudés puis véritablement souples apparurent au XIXe siècle. L'argent était alors le matériau le plus utilisé, à la fois en raison de ses propriétés antiseptiques et parce que c'est un métal malléable. Néanmoins, dès le milieu du XIXe siècle, on lui préféra le caoutchouc dont l'industrie était en plein essor en Europe.
Le concept de sondage vésical intermittent stérile fut introduit par Sir Ludwig Guttman durant la Seconde Guerre mondiale pour venir en aide aux nombreux blessés médullaires•G. Accusé de provoquer des infections urinaires, il fut remisé aux oubliettes. La technique refit pourtant surface aux États-Unis à la fin des années soixante lorsqu'il fut établi que les infections sont également liées à la stagnation des urines dans la vessie. Jusqu’à ce que les sondes à usage unique fassent leur apparition dans les années quatre-vingt, les sondes étaient nettoyées et réutilisées entre deux utilisations. Celles d'aujourd'hui sont en PVC, POBE (PolyOlefin-Base Elastomer), polyuréthane ou, plus rarement, en silicone. Les systèmes de revêtement et de lubrification des sondes au contact de l'urètre se sont eux aussi améliorés au fil des années. Certaines sondes sont prélubrifiées, autrement dit enduites de gel déjà réparti sur la sonde. Mais aujourd’hui, la majorité des sondes urinaires sont hydrophiles auto-lubrifiées, c’est-à-dire équipées d’un mécanisme de lubrification réactif à l’eau et totalement solidaire de la sonde. Les patients amenés à se sonder plusieurs fois par jour y ont à l’évidence gagné en confort et en sécurité. Enfin, grâce aux efforts des fabricants, le design des sondes n'a plus rien à voir avec ce qu'il était au début des sondages intermittents. Petites, discrètes, les sondes d'aujourd'hui peuvent facilement être transportées, rendant ainsi aux utilisateurs une précieuse liberté de mouvement et d'action.
Sondage à demeure
En 1929, le chirurgien américain Frédéric Foley mit au point le cathéter à ballonnet dont l'usage se développa après-Guerre. Cette innovation ouvrit la voie au sondage urinaire à demeure. Les premières sondes vésicales à demeure étaient en caoutchouc, puis en PVC. Elles drainaient effectivement les urines mais provoquaient fréquemment des infections bactériennes ou des nécroses et avaient tendance à se boucher. Nombreuses étaient alors les victimes de "la fièvre du cathéter" qui résultait d'infections. Depuis, d'importants progrès ont été accomplis en matière de stérilisation des sondes urinaires tandis que le matériel est posé en conditions d'aseptie, ce qui limite le risque bactérien. Les recherches sur les matériaux ont elles aussi contribué à lutter contre les infections. Actuellement, les sondes urinaires à demeure sont en latex enduit de téflon, d'hydrogel ou de silicone, voire entièrement en silicone.
Eclairage
Infections sur sonde et autres complications
Nécessaire dans plusieurs indications, le sondage vésical n’en reste pas moins un facteur de risque de contamination et parfois d’infections urinaires qui, si elles se répètent, peuvent altérer le bon fonctionnement des reins. Le risque varie selon le patient, la méthode de sondage adoptée, sa durée et le type de sonde utilisée. La mise en place de la sonde étant un acte invasif, la manipulation et la pose du dispositif doivent être effectuées sous conditions d’asepsie. Les données de la littérature montrent actuellement que des systèmes alternatifs comme l’étui pénien pour les hommes et le sondage intermittent diminuent l’incidence des infections urinaires. Si ces systèmes sont utilisés, il faut surveiller les patients avec attention afin qu’ils ne développent pas de globe urinaire. En cas de sondage permanent, d’autres complications peuvent survenir, d’ordre mécanique, hémorragique, infectieux ou de sténose urétrale. En termes d’infections et d’atteinte des reins, le risque est moindre avec le sondage intermittent mais ce dernier peut être responsable de microtraumatismes ou de saignements par irritation de l’urètre au moment du passage de la sonde.
9. Poches urinaires
Vers plus de confort et de discrétion
Un cancer de la vessie ou certaines maladies neurologiques peuvent entraîner de graves dysfonctionnements de la vessie. Lorsqu’aucune solution n’est possible pour drainer les urines, une intervention chirurgicale s’impose afin de créer une ouverture artificielle sur la paroi abdominale et de dévier vers elle les urines. Certaines dérivations peuvent être continentes : le patient vidangera alors ses urines par sondage. D’autres dérivations, non continentes, appelées urostomies, permettent l’évacuation des urines dans une poche de recueil. Elles sont généralement placées du côté droit de la paroi abdominale en dessous de la ceinture.
En cas de dérivation urinaire non continente, l’urine s’évacue au fur et à mesure de sa production par les reins dans une poche de recueil. Il existe deux types d’appareillages de poches urinaires externes. Les systèmes « une pièce » collés directement sur la peau doivent être changés tous les jours. Les systèmes « deux pièces » comprennent un support collé sur la peau sur lequel est positionnée la poche selon différents modes de couplage mécanique ou adhésif. La poche, munie d’un système de vidange, est changée elle aussi tous les jours mais le support reste en place plus longtemps (2 à 3 jours maximum). En cas de dérivation continente, la vessie interne doit être vidée par autosondage vésical. La sonde est alors introduite par la stomie.
La première mention d’appareillages de recueil d’urine dans les catalogues de matériel médical remonte à 1900. Dans les années trente, naquirent des poches en caoutchouc équipées d’une ceinture. Les réservoirs, métalliques, étaient remplis de cellulose et maintenus par un corset. Ils étaient très visibles, sources d’allergies et fuyaient souvent. Faute de mieux, le système perdure néanmoins jusque dans les années cinquante, avec des réservoirs en verre puis en plexiglas. Alors que l’industrie des matières plastiques se développa après-Guerre, les premiers appareillages à poche synthétique furent mis au point. Munies d’un anneau en fer, celles-ci pouvaient être vidangées et jetées. En 1954, Elise Sorensen, une infirmière danoise, mit au point une poche non poreuse, mince et élastique. Bien que l’avancée concernât d’abord les stomies digestives, elle bénéficia bientôt aux stomies urinaires également. À la même période, les poches auto-adhésives, alors recouvertes d’une couche d’oxyde de zinc, virent le jour. La protection cutanée laissait encore à désirer. Les poches avec support en gomme de Karaya végétale, extraite d’arbres en Inde et commercialisée à partir de 1964, apportèrent une première solution à ce problème. Le matériau comblait les petites aspérités de la peau autour de la stomie en laissant la peau propre et sèche et il maintenait le sac de recueil à distance de la peau. À la fin de la décennie, les industriels s’inspirèrent des emplâtres utilisés par les chirurgiens-dentistes et proposèrent les premières gommes hydrocolloïdes faites de particules absorbantes : elles facilitent la guérison de la peau irritée et se retirent facilement.
Dans les années soixante-dix, les films plastiques bruyants et poreux furent remplacés par des films multicouches, d’abord à trois épaisseurs, beaucoup plus performants. Les poches devinrent alors plus silencieuses, moins odorantes et moins sujettes aux fuites. Elles étaient dotées de système anti-reflux, une innovation décisive pour éviter les remontées d’urine et, par là-même, les infections. Les systèmes deux pièces arrivèrent en 1978. L’avancée pour les patients fut significative : le support adhésif restait en place pendant deux à quatre jours. Seule la poche devait être retirée, ce qui était moins contraignant et agressif pour la peau que de devoir retirer tout l’appareillage trois à quatre fois par jour. Les films cinq couches, étanches et très souples, virent le jour au cours des années quatre-vingt-dix. Ils sont toujours utilisés actuellement. Peu à peu, les matériaux plastiques cédèrent le pas au tissu tissé qui agresse moins la peau. Les poches d’aujourd’hui sont couleur peau, bien moins visibles. Concernant le camouflage des odeurs et des bruits, des filtres furent inventés dès les années quatre-vingt et proposés aux patients stomisés. D’abord distincts de la poche, ils lui sont désormais intégrés. Aujourd’hui, la recherche se tourne vers la mise au point d’implants qui permettraient de supprimer les poches urinaires et de les remplacer par des vidanges totalement intégrées.
Eclairage
« La qualité de vie dépend en grande partie de l’appareillage »
Danièle Chaumier, Présidente de l’association française d’entérostoma-thérapeutes.
« Les tout premiers systèmes d’appareillage avaient tendance à fuir. Puis ce problème a été réglé par les fabricants mais le matériel n’était pas toujours confortable. Aujourd’hui, nous disposons de toute une gamme de produits à la fois sécurisants, souples et qui ne fuient pas. Les protecteurs cutanés tiennent bien sur la peau, ce qui n’a pas toujours été le cas. Ces progrès sont indéniables et apportent un vrai plus pour la personne stomisée. Pour autant, le dispositif idéal, qui se vidange facilement, s’emboîte bien et tient parfaitement quel que soit le patient, n’est pas encore sur le marché. »
10. Sonde double J
Un tuteur aux extrémités arrondies
Le développement de la chirurgie mini-invasive, cœlioscopie en tête, contribue à l’essor d’une chirurgie urologique moins agressive, moins douloureuse et plus précise. Au grand bénéfice des patients... comme des chirurgiens.
La pose d'une sonde double J, aussi appelée sonde JJ ou prothèse autostatique endo-urétérale, sert à prévenir ou à contourner un obstacle situé au niveau de l'uretère. Elle est utilisée dans le cadre du traitement des calculs du rein ou de l'uretère pour faciliter l'évacuation de fragments de calculs. En effet, lorsque le calcul a été fragmenté, il est fréquent que de petits débris migrent dans le canal et bloquent totalement ou partiellement l’écoulement des urines. Cette situation entraîne des douleurs importantes, appelées coliques néphrétiques, et des infections urinaires.
La sonde double J est un tube souple et fin dont les extrémités dessinent chacune une boucle. Cette forme permet à la sonde de rester en place entre le rein et la vessie. Elle est introduite par les voies naturelles et posée dans l'uretère, ce qui permet à l'urine de s'écouler à travers elle du rein vers la vessie. Elle peut rester en place jusqu'à trois mois, voire un an dans certains cas.
La pose de sondes double J fait aujourd'hui partie des gestes les plus couramment pratiqués par les urologues, et ce dans une multitude d'indications concernant le haut appareil urinaire : tumeurs, sténoses, lithiases etc. Pourtant, il y a encore cinquante ans, placer un tuteur dans l'uretère relevait du fantasme. Le concept d’endoprothèse urétérale de type double J a été décrit pour la première fois en 1967 dans le but de traiter des sténoses urétérales. Celui-ci avait toutefois tendance à bouger dans l'uretère, ce qui en limitait l'intérêt au bout de quelque temps. Des améliorations furent apportées au dispositif en 1976 avec l'ajout de petites ailettes latérales pour éviter l'expulsion de la prothèse, de trous latéraux sur toute sa longueur et d'un renflement au niveau de l'extrémité positionnée au niveau de la vessie afin que le tuteur ne descende pas.
Il fallut encore attendre deux ans avant que Finney décrive, en 1978, la véritable sonde double J avec une crosse au niveau du bassinet rénal et une seconde au niveau de la vessie. Le modèle séduisit par son efficacité et sa stabilité dans l'uretère, favorable à un bon drainage des urines dans la durée. Le principe étant acté, d'autres sondes du même type virent le jour par la suite pour en améliorer la statique. Ainsi les extrémités en J sont-elles aujourd'hui remplacées par des boucles appelées pigtail (queue de cochon en anglais). Les matériaux aussi sont l'objet d'innovations car ce sont eux qui conditionnent la durabilité de l'implant et surtout sa tolérance par l'organisme. Ce dernier doit être suffisamment flexible pour garantir le confort du patient sans pour autant s'effondrer sous l'effet de la compression. Il faut aussi qu'il soit résistant vis-à-vis des urines et de leur pouvoir dégradant et qu'il puisse être posé facilement, sans frotter contre les parois de l'uretère. Plusieurs années de recherche permirent aux fabricants de tirer le meilleur profit des matériaux alliant ces propriétés telles que le silicone, le poyluréthane, le métal et différents polymères. Des traitements de surface furent par ailleurs mis au point afin de faciliter la glisse de la sonde mais aussi et surtout pour éviter les phénomènes d'incrustation qui figurent parmi les principales complications des sondes JJ. En effet, l'appareil urinaire baigne dans un milieu riche en calcium et en microbes. Ces derniers déposent sur tous les corps étrangers un biofilm qui capte le calcium environnant. La sonde JJ n'échappe pas à ce phénomène et a tendance à se calcifier. Elle devient alors difficile à retirer pour le chirurgien.
11. Lithiases rénales
Souffrez que je vous retire ces calculs
En France, les coliques néphrétiques concernent chaque année près de 120 000 personnes (de 1 à 2 % des urgences quotidiennes). Elles sont généralement l’expression douloureuse d’une lithiase rénale, pathologie fréquente et récidivante dont la prise en charge chirurgicale a été réinventée en l’espace de trois décennies. Hier uniquement symptomatique, son traitement est devenu curatif grâce à deux inventions majeures, le lithotriteur et l’urétéroscope.
La lithiase désigne la maladie caractérisée par la formation de calculs dans les reins ou dans les voies urinaires. Un calcul est un amas compact d’une ou de plusieurs substances cristallisées sous l’effet d’une trop grande concentration de cette ou de ces substances dans l’urine. Une colique néphrétique se manifeste lorsqu’un de ces calculs vient se loger dans le rein ou dans l’un de ses canaux de sortie, les uretères. Les voies en amont de l’obstacle se dilatent, ce qui provoque une douleur aiguë et violente ressentie dans le dos. Il est nécessaire d’intervenir rapidement pour protéger le rein d’une éventuelle perforation et/ou infection. Le traitement vise en premier lieu à enrayer ce risque et à supprimer la douleur puis à retirer l’obstacle. Pour cela, et selon les caractéristiques du calcul, plusieurs options s’offrent au chirurgien. La lithotritie (ou lithotripsie) extracorporelle est le traitement de référence pour les petits calculs situés dans la partie haute de l’uretère. En cas de calculs durs ou plus volumineux, plus difficiles à déloger, les techniques endo-urologiques comme l’urétéroscopie rigide ou souple sont alors indiquées.
La lithotritie extracorporelle (LEC) consiste à envoyer des ondes de choc depuis l’extérieur du corps sur un calcul pour le fragmenter. Actuellement, la technique est un succès dans près de 90 % des cas, surtout si le calcul n’est pas trop dur. Ces ondes de choc sont produites par un générateur et dirigées sur le calcul par un système de visée à repérage radiographique et/ou échographique. Les fragments de calculs s’évacuent par les urines. Le traitement nécessite une à deux séances.
L’urétéroscopie consiste à introduire dans l’uretère par les voies naturelles un instrument optique qui mesure environ 3 mm de diamètre et permet de travailler sous contrôle de la vue. Il contient un canal de travail à travers lequel sont introduits les instruments nécessaires à l’intervention, notamment le panier dans lequel sera recueilli le calcul. Certains urétéroscopes sont métalliques et rigides, d’autres sont flexibles. L’urétéroscope peut remonter jusqu’aux cavités rénales si nécessaire. Dans l’urétéroscopie souple laser, l’appareil est équipé d’un laser dont l’énergie est déployée au contact du calcul pour le fragmenter.
Le début des années quatre-vingt marque aussi un tournant dans l’histoire des techniques visant à débarrasser le patient des calculs qui menacent l’intégrité de ses reins et de ses uretères. Jusque-là, l’unique solution thérapeutique relevait de la chirurgie à ciel ouvert. À l’époque, les ingénieurs en aéronautique utilisaient déjà des lithotriteurs. Les ondes de choc qu’ils déployaient servaient à tester la solidité de la carlingue des avions de chasse. Une société allemande développa le premier lithotriteur destiné à l’urologie en 1980. L’appareil installé à Münich était lourd et encombrant. Le sol et le plancher de la pièce devaient être renforcés pour l’accueillir. Cette machine de première génération fonctionnait avec un repérage radiographique du calcul et nécessitait une anesthésie générale ou une péridurale car le passage des ondes à travers les lombaires est douloureux. Le patient était immergé dans une baignoire d’eau chauffée et dégazéifiée de nature à véhiculer les ondes de choc émises par la machine. La technique de la lithotritie extracorporelle (LEC), qui se popularisa sous l’appellation de baignoire, s’imposa rapidement en raison de ses bons résultats thérapeutiques qui permirent à 60 à 70 % des patients qui en bénéficiaient avec succès d’échapper au bistouri. Dès 1985, apparurent les lithotriteurs à poche sèche. Le patient n’était plus immergé dans l’eau car celle-ci était contenue dans une membrane. Le système devint ainsi plus hygiénique et plus confortable pour le patient. Dans la foulée, des appareils avec repérage uniquement échographique furent mis au point. Une autre génération d’appareils, équipés du double repérage, vit le jour au milieu à partir du milieu des années quatre-vingt-dix. Les ondes de choc n’étaient plus électrohydrauliques mais générées par induction magnétique ou piézoélectrique•G puis électromagnétique. L’anesthésie n’était plus nécessaire, ce qui permit d’utiliser la technique en ambulatoire.
L’urétéroscopie prend le relais
Quelque quinze ans après les premiers traitements par lithotritie extracorporelle (LEC), l’engouement des premières années fit place à quelques déceptions. La technique avait bel et bien révolutionné la prise en charge thérapeutique des lithiases rénales mais certains calculs, notamment les plus petits et ceux positionnés dans les cavités rénales, continuaient de lui résister. Ce constat mèna urologues et industriels à explorer d’autres voies potentielles de traitements moins invasives que la chirurgie ouverte et capables de pallier les échecs thérapeutiques de la LEC. L’urétéroscopie imaginée au début des années quatre-vingt par Martinez-Pineiro et Perez-Castro (voir le chapitre 1) se développa, mais elle resta encore peu pratiquée et réservée aux patients chez qui la lithotritie échouait. Il est vrai que la technique restait encore très contraignante dans la mesure où les extracteurs de calculs consistaient en des systèmes de poids destinés à faire progresser le calcul de proche en proche dans l’uretère. L’extraction demandait plusieurs jours, que le patient passait à l’hôpital. La situation change au milieu des années quatre-vingt-dix avec l’arrivée d’instruments endoscopiques adaptés pour traiter les calculs rénaux par les voies naturelles. Alors que la LEC touchait à ses limites, le recours à l’urétéroscopie ne cessa d’augmenter, porté par un matériel de plus en plus performant et des procédures opératoires plus rapides et tout aussi efficaces sur le plan thérapeutique. La miniaturisation des dispositifs médicaux contribua largement à cet essor. Elle rendit notamment possible la mise au point de nouveaux instruments technologiques comme les urétéroscopes semi-rigides équipés d’une sonde, dite aussi sonde de Dormia. Celle-ci embarquait à son extrémité un panier en alliage à mémoire de forme qui permettait de recueillir les calculs dans n’importe quelle zone du rein en vue de leur extraction. La chirurgie percutanée se développa pour accéder aux calculs situés dans les reins et s’imposa progressivement comme le traitement de référence des calculs volumineux dont la LEC ne parvenait pas à venir à bout. Parallèlement furent mises au point des techniques de fragmentation des calculs qui permettaient de réduire leur taille avant de les chercher à les extraire. Ultrasons, ondes de choc et laser pulsé furent mis à profit pour détruire tous les types de calculs, du plus friable au plus dur, in situ c’est-à-dire à l’endroit où ils se trouvent dans l’appareil urinaire. Les débris étaient éliminés naturellement ou à l’aide d’une sonde double J (voir page 27).
L’urétéroscopie souple laser, qui permet de remonter par les voies naturelles jusqu’au rein pour y détruire les calculs, naquit et se développa à partir des années deux mille, sous l’effet d’un concours de circonstances favorables : le coût de la technologie laser, jusqu’alors rédhibitoire pour un usage en urologie, avait diminué et celle-ci s’avéra compatible avec les urétéroscopes miniatures. L’urétéroscopie et l’urétéro-rénoscopie, techniques mini-invasives, tendent aujourd’hui à prendre le pas sur la néphrolithotomie percutanée.
Eclairage
Néphrolithotomie percutanée, kesako ?
La néphrolithotomie percutanée est une intervention chirurgicale qui consiste à ponctionner les cavités rénales à travers la peau de la zone lombaire du dos. Une gaine y est ensuite introduite. Elle sert de guide jusqu’au rein et permet d’introduire un néphroscope souple ou rigide, instrument dont le chirurgien se sert pour voir l’intérieur du rein et retirer les calculs rénaux qui s’y trouvent. S’ils sont trop volumineux, il est possible de les fractionner de manière à extraire les fragments.
Eclairage
Des solutions pour conserver les organes
Les premières transplantations rénales à partir de donneurs vivants eurent lieu dans les années cinquante. À l’époque, les reins étaient refroidis par contact et quelquefois lavés avec du liquide de Ringer. Dans les années soixante-dix, alors que se développait le prélèvement sur des donneurs en état de mort encéphalique, les temps d’ischémie des organes augmentèrent. Un certain nombre de centres commencèrent alors à s’intéresser aux liquides de conservation d’organe. Un médecin britannique, Collins, mit au point une solution dont la composition était proche de celle du milieu intracellulaire. Le réseau Eurotransplant modifia quelque peu sa composition, ce qui donna naissance à l’Eurocollins. À la fin des années quatre-vingt, une autre solution baptisée UW car élaborée par l’Université du Wisconsin aux États-Unis, démontra sa supériorité sur l’Eurocollins. Malgré quelques faiblesses, elle s’est progressivement imposée comme la solution de référence.
12. Prostate
Des traitements de plus en plus conservateurs
Les technologies laser revisitent le traitement chirurgical de l’hypertrophie bénigne de la prostate. En ciblant avec une grande précision la zone à traiter, elles contribuent à mieux conserver les tissus voisins et à réduire les complications post-opératoires.
L’Hypertrophie Bénigne de la Prostate (HBP) est une affection fréquente liée au vieillissement et qui survient le plus souvent chez l’homme de plus de 50 ans. Elle correspond à une augmentation du volume de la prostate, lequel constitue alors un obstacle à l’écoulement des urines et peut irriter la paroi de la vessie. Ses manifestations fonctionnelles urinaires affectent la qualité de vie et peuvent être à l’origine de complications potentiellement graves. La résection endoscopique et la chirurgie ouverte appelée adénomectomie constituent les techniques chirurgicales de référence, respectivement pour les prostates de moins et de plus de 80 g. Les
technologies lasers, de plus en plus employées, permettent de s’affranchir de certaines contraintes, en particulier de celles liées à la taille de l’organe.
La résection endoscopique, qui ne laisse pas de cicatrice, consiste à élargir le canal de l’urètre situé dans la prostate en enlevant l’adénome qui l’entoure et qui empêche l’écoulement de l’urine. Le chirurgien introduit dans le canal de l’urètre un endoscope afin de repérer la prostate. Le résecteur est muni d’une anse électrique ou d’un laser qui servent, selon la technique choisie, soit à découper la prostate en copeaux de différentes tailles, soit à la vaporiser. Le laser agit en provoquant rapidement une élévation de température des tissus, ce qui a pour effet de les détruire. La technique la plus répandue actuellement utilise une fibre laser Holmium de forte puissance qui découpe l’adénome en blocs. Repoussés dans la vessie, ils sont débités à l’aide d’un morcellateur puis évacués par les voies naturelles au moyen d’une sonde vésicale. La technique Greenlight emploie une fibre laser KTP. Introduite dans l’urètre, elle crée un chenal jusqu’à l’adénome situé au centre de la prostate et le vaporise sur place.
Les premières utilisations concluantes des technologies laser pour traiter l’hypertrophie bénigne de la prostate remontent au milieu des années quatre-vingt. Un laser KTP de puissance relativement faible (38 Watt) fut alors utilisé pour inciser des prostates de petit volume. Ces premières expériences de vaporisation se soldèrent par une diminution du taux et de la durée de rétention urinaire post-opératoire. A la fin des années quatre-vingt-dix, des laser KTP à haute puissance (60W) commencèrent à être utilisés et produisirent des effets thérapeutiques comparables à ceux de la résection endoscopique classique, associés à des complications minimes. Ces tentatives démontrèrent par ailleurs l’absence de danger à ce niveau de puissance. La technique s’imposa alors dans le paysage comme une alternative possible à la chirurgie classique et ce, malgré son coût important. La technologie fut perfectionnée et une deuxième génération d’appareils de vaporisation naquit en 2005. La puissance du laser augmenta progressivement pour atteindre 80, 100 puis 120 W. L’absence de saignement est un avantage indéniable pour les patients sous anticoagulants ou sous antiagrégants plaquettaires qui peuvent être opérés sans interruption de ces traitements. Les premiers essais avec le laser Holmium sont un peu plus récents puisqu’ils datent du milieu des années quatre-vingt-dix. La technique des débuts fut laborieuse et surtout plus lente que la résection endoscopique classique. De fait, il était nécessaire de retirer à la pince les copeaux amassés dans la vessie et cette opération prenait du temps. La mise au point du morcellateur, ou aspirateur mécanique, constitua à cet égard un véritable progrès et facilita la résection de larges fragments de prostate. Améliorée en 1998, la technique permit dès lors d’obtenir des résultats thérapeutiques au moins équivalents aux chirurgies de référence que sont la résection endoscopique et l’adénomectomie. Pour les prostates de gros volume, l’énucléation s’avère même plus efficace que la résection classique.
Enfin, à côté des avancées médicales qu’elles offrent, les technologies laser ouvrent la voie aux traitements ambulatoires des pathologies de l’hypertrophie bénigne de la prostate. La durée de séjour du patient à l’hôpital s’en trouve diminuée et sa qualité de vie améliorée.
Eclairage
Des ultrasons contre le cancer de la prostate.
La technique des ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU) consiste à émettre, via une sonde endorectale, un faisceau d’ultrasons d’énergie élevée sous forme de courtes impulsions. L’effet thermique ainsi généré brutalement détruit définitivement les tissus visés, ce qui induit à terme une fibrose complète de la prostate. L’impact du traitement sur les organes voisins est limité et les effets secondaires considérablement réduits. La durée d’hospitalisation diminue elle aussi. Le progrès est également technologique car il a fallu des années de recherche pour maîtriser l’effet thermique produit par un faisceau d’ondes ultrasonores et explorer son potentiel thérapeutique. Les premiers patients traités par HIFU pour une tumeur localisée de la prostate l’ont été il y a vingt ans. Auparavant et pendant près d’un siècle, la prostatectomie totale, dite aussi radicale, était la seule option thérapeutique offerte au patient qui devait, jusque dans les années quatre-vingt, composer avec des effets secondaires importants et quasi systématiques : pertes sanguines importantes, incontinence urinaire fréquente, impuissance sexuelle. Malgré les améliorations de la technique permettant de mieux conserver les sphincters et les structures vasculaires et nerveuses, les troubles de la continence et de l’érection n’ont pas totalement disparu. Dans un tel contexte, l’arrivée au milieu des années quatre-vingt-dix d’un traitement à la fois mini-invasif et plus protecteur représente une avancée médicale importante. Actuellement, une nouvelle génération de machines couple les ultrasons thérapeutiques à un système de guidage par Imagerie par résonance magnétique (IRM). Les contours de la tumeur peuvent ainsi être ciblés sur l’écran de l’appareil avec une extrême précision.
Eclairage
« Limiter les saignements pour réduire les complications »
Dr Hervé Baumert, service d’urologie du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph.
« Les techniques chirurgicales traditionnelles, que sont la résection endoscopique de la prostate et l’adénomectomie par voie haute, sont des interventions relativement hémorragiques, qui nécessitent la pose d’une sonde urinaire et son maintien pendant plusieurs jours pour diluer le sang. Cela se traduit par des durées d’hospitalisation relativement longues, de l’ordre de quatre jours pour une résection endoscopique et de neuf jours pour une chirurgie ouverte, qui augmentent d’autant le risque de complications que représentent les infections sur sonde. De même, la survenue de saignements pendant l’intervention impose d’avoir recours à un sérum de lavage qui passe dans la circulation sanguine et peut provoquer un syndrome de réabsorption caractérisé par des troubles métaboliques et neurologiques. Réduire les saignements est donc un enjeu important dont les industriels ont bien conscience. A cet égard, le développement de l’endoscopie laser est une véritable révolution. L’hémostase est bien meilleure et le sérum de lavage devient inutile. Par ailleurs, la qualité des bistouris a évolué et les industriels proposent depuis une petite dizaine d’années des résecteurs bipolaires censés réduire les saignements pendant la résection et en post-opératoire. Leur plus-value reste encore controversée. »